 De Mathieu Gaborit, 1996-1997
De Mathieu Gaborit, 1996-1997
Abyme est composé de :
* Aux Ombres d’Abyme, 1996
* La Romance du démiurge, 1997
Quelques jours après Les Crépusculaires, j’ai donc terminé la deuxième partie de la très belle intégrale des Royaumes Crépusculaires. Premier constat : si les deux romans partagent un univers commun, en effet, ils sont très différents l’un de l’autre. Exit l’histoire classique de fantasy où un jeune orphelin traverse diverses épreuves pour sauver son amour/son pays/le monde (biffer la mention inutile). Là où Les Crépusculaires répondaient davantage au cahier des charges du roman de fantasy classique, Abyme relève d’un autre registre.
C’est en effet un roman policier, ni plus, ni moins. Certes dans un monde de fantasy original particulièrement bien développé, mais un policier néanmoins. On y fait la connaissance du farfadet Maspalio, ancien Prince-voleur (le chef de la guilde, quoi) de la cité cosmopolite d’Abyme. Le brave farafadet se voit obligé de sortir de sa douce semi-retraite pour se lancer à la poursuite d’un démon familier qu’une noble en mal de sensation forte aurait laisser s’échapper. Les démons, de toutes tailles et natures, rendent de multiples services à leurs invocateurs en échange d’une monnaie d’échange qui leur est propre (des richesses, d’autres services, la damnation éternelle, ce genre de chose, quoi). Mais pas de chance, ce démon-là refuse de revenir aux enfers dont il est issu. Et ça ne plait pas beaucoup à sa hiérarchie démoniaque qui entends bien le retrouver et lui faire entendre raison.
Et quel meilleur enquêteur pour retrouver une âme perdue que l’ancien chef de la guilde des voleurs, qui connait la ville comme sa poche et a ses relais dans toutes les strates de cette société complexe et multiculturelle ? Mais, bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévues et le (pas si) brave Maspelio se trouve embarquer dans une histoire nettement plus complexe qu’elle ne semble l’être au premier abord.
Comme dans Les Crépusculaires, Gaborit ne laisse que peu de répit à son lecteur : les évènements s’enchaînent à une vitesse frénétique dans ces chapitres toujours aussi courts et construits de manière à laisser le lecteur en attente de toujours tourner une page supplémentaire. C’est bourré d’action et de répliques cinglante dans une cité picaresque ressemblant par moment à une Venise fantastique et peuplée de races toutes plus exotiques les unes que les autres. Mieux même, Gaborit laisse tomber la gentille pudeur des Crépusculaires qui en faisait une campagne de JdR PG-13. Maspalio, lui, ne dit pas non aux plaisirs de la chair. Et Abyme compte nombres de quartiers dédiés aux plaisirs, bien sûr. Maspalio lui-même est un personnage plus humain qu’Agone de Rocheronde. Le fait d’avoir fait de son héros un retraité nous épargne évidemment le côté naïf et ingénu qu’Agone devait avoir au début de son périple. Maspalio en a vu d’autre et sa bande de vieux voleurs également.
En revanche, un bémol que j’avais à la lecture des Crépusculaires se confirme ici, voire même s’accentue. Gaborit, on le sent, à creuser son univers de campagne. Il maîtrise à la perfection la géographie de sa ville, connait les races extravagantes qui la peuple, sait quelle caste ou quelle couche sociale a quel rite et pourquoi. Et il détaille tout cela dans le livre de campagne d’Abyme, un JdR qui pouvait (et peut toujours) se jouer comme un standalone ou comme une extension à son premier JdR, Agone (qui développait donc l’univers des Crépusculaires, pour les inattentifs du fond de la classe). C’est très bien ; c’est comme ça qu’on crée un monde crédible et complexe pour servir de toile de fond à son roman. C’est ce qui rend l’action réaliste et l’histoire palpitante, puisqu’elle se déroule dans un monde qui, pour fantastique qu’il est, devient familier au lecteur.
Mais Gaborit oublie par moment que le lecteur de son roman n’a pas forcément acheté et lu le JdR du même nom. Et il ne détaille ou ne développe finalement que très peu de concepts dans son roman, laissant, et c’est logique vu le genre choisi, la place au développement de l’enquête et de ses quelques protagonistes principaux. Ce choix me rend cependant un peu malheureux et m’a parfois fait décrocher du roman : ok, le concept des « gros« , une caste d’obèses oisifs qui observent la cité et ses habitants depuis ses hauteurs, est pas mal réussi du tout. C’est visuellement très inventif et c’est rarement vu en fantasy. Mais… à quoi servent-ils, ces gros ? D’où viennent-ils ? Quelle est leur fonction dans la cité d’Abyme ? Et je ne prends là qu’un exemple parmi beaucoup d’autres de concepts qui, bien que très inventifs, sont jetés à la tête du lecteur sans beaucoup d’autres explications et sont finalement peu exploités au-delà de leur aspect « exotique« . Dommage, car cela aurait enrichi la lecture et aider à dévoiler davantage le monde qui semble très construit et cohérent de Gaborit. J’espère que le nouvel opus d’Abyme, sorti il y a deux ans déjà maintenant, prend davantage son temps et exploite mieux son cadre, l’auteur ayant eu vingt ans pour se perfectionner entre les deux.

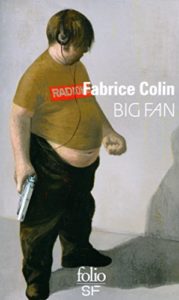 De
De 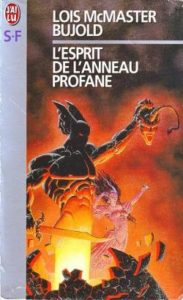 De
De 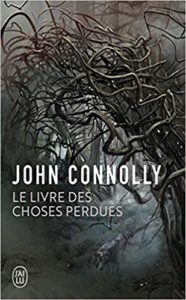 De
De