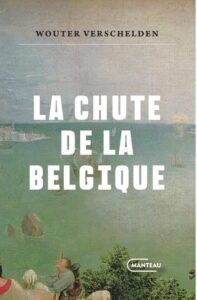 Wouter Verschelden, 2024.
Wouter Verschelden, 2024.
Troisième livre du journaliste du Standaard (et du Morgen, de la VRT et de Newsweek) consacré à la politique belge en quelques années, après bpost Hold Up, sur l’affaire des aides d’Etat à la poste belge et surtout après Les Fossoyeurs de la Belgique, relatif à la formation du gouvernement Vivaldi actuellement démissionnaire, La Chute de la Belgique conclut donc cette trilogie liée au gouvernement De Croo (bien que le scandale de bpost ait débuté il y a bien longtemps). Et la conclut dans les larmes et le sang. Car la Vivaldi, gouvernement d’équilibristes ayant subi consécutivement la crise du COVID-19, la guerre en Ukraine et les chutes des démocraties un peu partout dans le monde, n’a pas été un long fleuve tranquille. Que du contraire.
Wouter Verschelden, désormais rompu à l’exercice, reprend la forme qu’il avait déjà utilisée dans ces deux premiers bouquins, composée de chapitres courts et incisifs, entrecoupés de portraits, parfois au vitriol, des différents protagonistes. Peu sourcé, le bouquin se veut davantage une chronique du naufrage politique qu’a été la Vivaldi au cours de ces cinq ans d’existence, de frustrations en coups bas, d’attaques en trahisons. Car c’est bien de cela que parle le livre : de l’univers impitoyaaaaaable (avec la musique de Dallas, of course) de la Rue de la Loi. L’évolution notable que Verschelden ne manque pas de souligné est le rôle de plus en plus important que jouent les Présidents de parti dans la vie du gouvernement. Que ce soit pour le critiquer de l’extérieur comme « opposition« , alors qu’ils en sont membres, ou que ce soit pour décider en kern en lieu et place de leur vice-premier (souvent inexpérimentés) qui ne sont plus alors de que des hommes et des femmes de paille, cela change drastiquement la dynamique. Faire coalition devient presque impossible, dans ces conditions, où le moindre compromis devient une bataille homérique et, souvent, ridicule.
Car c’est cela qui ressort de la lecture de chronique quotidienne d’un vaste naufrage : sans tomber dans le poujadisme de bas étage, nous sommes malheureusement dirigés par des médiocres, des incultes, des dogmatiques et des lâches. Ça fait mal de le lire, cela me fait aussi mal de l’écrire. Et c’est sans doute parce que je deviens un vieux con et que, professionnellement, j’en côtoie un certain nombre très régulièrement que je commence doucement mais surement à désespérer. Où sont nos grandes femmes et hommes d’Etat ? Où sont ceux qui croient en un modèle de société et qui souhaitent le défendre au-delà des intérêts particuliers d’un groupuscule x ou y ? N’ont-ils seulement jamais existé ? Est-ce que les mémoires d’hommes et de femmes politiques d’après-guerre qui ont construit ensemble, parfois habillement, parfois naïvement, les démocraties de luxe que sont les pays européens occidentaux, est-ce que ces mémoires mentaient ?
En effet, un autre point qui m’a frappé à la lecture du bouquin de Verschelden est l’absence totale de l’intérêt citoyen. A aucun moment dans les dossiers qui sont évoqués au fil des pages, dans les répliques assassines et les commentaires oiseux que les uns et les autres s’échangent, à aucun moment il n’est question du belge. A quelques reprises, des tensions éclatent autours des intérêts de l’un ou l’autre groupe de pression, au premier rang desquels nos charmants amis du Boerenbond (une association des agriculteurs flamands, dotée d’un riche trésor de guerre, proche historiquement de ce qui fut le premier parti belge pendant des années : les démocrates-chrétiens flamands. Mais aussi une association qui a poussée au développement de l’élevage en batterie pour des questions de rentabilités et qui lutte depuis des années contre toutes les initiatives liées à l’interdictions de produits dangereux dans l’agricultures, que le danger soit pour la santé humaine, la pollution des sols ou l’incidence sur le changement climatique ; bref, des gens très sympathiques…) Et personne d’autre. L’impact des politiques publiques ? On s’en tape. Le résultat auprès du citoyen ? On s’en fout. Non, ce qui compte, c’est la politique des petites déclarations, la politique en moins de 120 caractères sur X, haut lieu de la non-démocratie actuelle.
La lecture de ces chroniques, pour intéressante qu’elle soit pour mieux disséquer le cadavre de la Vivaldi, m’a donc davantage déprimée que rassurée. Car même si la Belgique se cherche encore un gouvernement fédéral, c’est avec la même bande de zigottos autours de la table. Le renouveau politique/citoyen tant attendu par les grandes démocraties mondiales, qui croulent sous les auspices et les augures qui clament à tue-tête la mort du modèle démocratique, ne se fera pas avec cette génération de professionnels de la politique. Je ne pense pas utile de rentrer dans le détail des affaires évoquées dans le bouquin : il n’y en a pas une pour rattraper l’autre. Le mot d’ordre semble être la politique du plus petit commun dénominateur. Et quelles que soient les ruses machiavéliques utilisées par les uns et les autres pour bénéficier d’une meilleure image, force est de constater que cela ne marche pas. Ou plus.
On notera finalement pour les plus courageux qui ne sont pas rebutés par ma longue diatribe que le bouquin souffre d’un mal particulièrement belge. Si son sujet est à coup sûr la chute de la Belgique à travers les pérégrinations de la Vivaldi, nombre de chapitre sont également consacré à la vie politique flamande, puisqu’elle avait (et a toujours) un impact direct sur les équilibres du fédéral. Mais pas un mot sur les gouvernement wallons ou bruxellois. Comme quoi, Wouter Verschelden, pour belgicain qu’il soit, n’a tout de même pas franchi le Rubicon ou, comme on l’appelle par chez nous, la frontière linguistique. Ce qui déforce quand même méchamment son propos en déséquilibrant une partie des rapports de force. Mais cela reste une belle chronique de la médiocrité politique, un parfait manuel de ce qu’il ne faut pas faire ou, mieux, pas être si l’on souhaite s’engager en politique.


 D’
D’ De
De 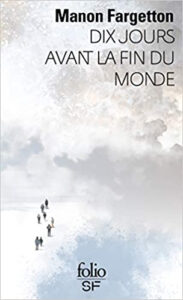 De
De