 De Poppy Z. Brite, 1993.
De Poppy Z. Brite, 1993.
En 1993, lorsque Poppy Z. Brite a débuté sa période de gloire dans la littérature de genre, elle était encore une femme. Maintenant, 30 plus tard, Poppy Z. Brite, de son vrai nom Billy Martin, a changé de genre et est devenu ce qu’il a toujours, semble-t-il, souhaité être : un homme homosexuel. J’utiliserai donc le masculin dans la suite de ce billet, puisque l’auteur en a décidé ainsi. Et ce prolégomène, qui ne s’intéresse qu’à la vie privée de l’auteur, est une précision nécessaire pour bien saisir l’œuvre de Brite.
En effet, ce recueil de nouvelles, préfacé par nul autre que l’excellent Dan Simmons, est fort marqué par les choix de vie de son auteur. Ainsi, à travers les douze courtes nouvelles, Brite met principalement en scène des hommes, jeunes, minces, androgynes et homos pour la plupart (ou bisexuels, pour faire bonne mesure). D’une certaine manière, la lecture du recueil m’a fait de nombreuses fois penser aux shôjos des années 90 et, en particulier, à la production de Kaori Yuki (Angel Sanctuary, Comte Cain, etc.) où des bishounens torturés souffrent à longueur de tome d’un mal-être existentiel souvent provoqué par des frustrations sexuelles inexprimées. Sans même parler de la production yaoi (à savoir des mangas destinés aux jeunes femmes et mettant en scène les émois homosexuels, explicites ou suggérés, entre de beaux jeunes hommes).
Pourquoi cette digression vers le monde du manga ? Et bien parce que c’est, je pense, à peu près le même public qui est visé et les mêmes tropes qui sont utilisés dans ces nouvelles de Poppy Z. Brite. L’auteur poursuit en effet le mouvement entamé par An Rice en 1976 avec son Entretien avec un Vampire et l’amène vers de nouveaux horizons. Brite est connu comme l’un des auteurs majeurs de la tendance splatter horror (= mise en scène très graphique et explicite de l’horreur, à l’instar de l’oeuvre de Clive Barker, inspiré du giallo italien et des séries B américaines d’horreur des années 70/80) au début des années 90. Pourtant, très honnêtement, même si Brite n’évite en effet pas les scènes explicites et a certaine fascination pour la mort, la torture, le glauque et le sexe, tout cela reste relativement sage. Je me souviens que les auteurs « inspirés » par Poppy Z. Brite sont nettement plus dérangeants, par exemple dans les recueils Eros Vampire édités par Brite lui-même quelques années plus tard.
Brite est en effet encore fort marqué par les grands récits gothiques (l’une des nouvelles s’ouvre d’ailleurs sur une référence directe à Lovecraft) des 18 et 19èmes siècles et cela se sent, se voit, se lit dans ses textes. Brite a par ailleurs un talent certain avec sa plume : les nouvelles sont définitivement de très bonne facture quant à leur style. Proches de la poésie, les descriptions des lieux comme des sentiments des protagonistes sont particulièrement agréables à lire, bien servies également par une traduction de très bonne facture. L’ensemble se révèle donc être un recueil de nouvelles érudites, poétiques, dramatiques et sinistres, mêlant allègrement l’hommage à une certaine forme de classicisme gothique et des concepts et réalités davantage punks et modernistes.
Pourtant, et malgré la qualité intrinsèque des textes ici présentés, le recueil s’oublie assez vite. C’est d’ailleurs, si vous me permettez la généralisation, le problème de la carrière complète de l’auteur : s’il a marqué le genre pendant quelques années en proposant quelque chose de neuf et de construit, ses textes sont tombés assez vite dans l’oubli. La raison en est selon moi assez simple : ils sont très marqués dans leur temps. On y voit, on y respire, on y vit une certaine forme de nihilisme grunge & goth très marqué dans l’imaginaire du début des années 90. Par ailleurs, même si les nouvelles proposent des trames assez diverses, du zombie aux fantômes en passant par le conte macabre, ils ont le grand défaut d’être trop semblables l’un à l’autre. Calcutta, seigneur des nerfs, seule nouvelle primée du recueil, en est sans doute la meilleure : elle offre une relecture intéressante et désespérée du concept de zombie. Mais pour les autres, bien vite, les différentes histoires ont tendance à s’effacer de la mémoire du lecteur pour se mélanger et laisser un souvenir confus d’histoires mélodramatiques, où les frustrations et perversions sexuelles se mélangent aisément avec un goût prononcé pour le macabre, l’horreur et le désespoir.
Poppy Z Brite lui-même en a d’ailleurs eu marre après quelques années et a choisi de quitter la littérature de genre pour passer à des textes plus positifs et brillants, arguant que cette fascination pour l’horreur avait un effet négatif sur son équilibre mental. On ne peut que le croire, mais force est de constater qu’il a depuis lors complètement disparu de la circulation et n’a plus été mentionné qu’en raison de sa transition de genre et non plus, malheureusement, pour ses œuvres. Reste à soulever notre verre d’absinthe (la fée verte éponyme, pour les inattentifs) en hommage à la carrière en forme d’étoile filante de la littérature de genre dont le recueil ici chroniqué est sans doute le parangon de sa production. Santé.

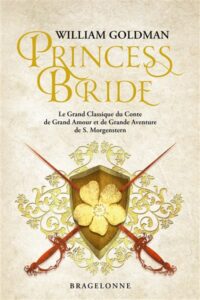 De
De  De
De  De
De 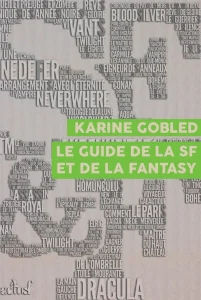 De
De