 De Simon McQuoid, 2021.
De Simon McQuoid, 2021.
A l’instar de Kamel Debbiche (que ceux qui ne saisissent pas la vanne se tapent rapidement l’intégrale de CROSSED… et de CHROMA), cela va faire 30 ans que j’attends une bonne adaptation de jeu vidéo au cinéma. Et force est de constater que la meilleure adaptation est et reste Scott Pilgrim vs. the World, qui, pour rappel, n’est pas basé sur un jeu vidéo. Quelques années après le World of Warcraft dont j’attendais beaucoup (Duncan Jones a totalement foiré sa life et ne s’en est pas encore remis comme réalisateur) et alors que je n’ai pas encore osé regarder Monster Hunter (de l’ineffable mais increvable Paul W.S. Anderson), les éléments étaient contre moi. Le film des années 90 (signé par… Paul W.S. Anderson, bien sûr !) ayant fait la joie de mon adolescence et les jeux ayant à de nombreuses reprises bousillés mes pouces sur SNES à l’époque, il était inévitable que je me laisse tenter par le nouveau Mortal Kombat.
Et bien, ne laissons pas le suspens s’installer : c’est naze. Naze de chez naze. Ok, il y a bien quelques plans à sauver et quelques gimmicks amusants. Les premières minutes, se passant au Japon médiéval, et voyant l’affrontement de deux ninjas destinés à devenir Sub-Zero et Scorpion sont réellement sympathiques, essentiellement grâce à la présence à l’écran d’Hiroyuki « San-Ku-Kai » Sanada qui, du haut de ses 60 ans, a une classe absolue. Mais on déchante très vite quand on se rend compte qu’on va suivre en fait la trajectoire d’un héros lambda et interchangeable, un certain Cole Young, champion de MMA raté, joué par le musclé mais insipide Lewis Tan. Outre le choix fort étrange d’introduire un nouveau personnage dans la mythologie de Mortal Kombat (sérieux, il doit y avoir dans les 100 personnages joueurs quand tu cumules les 11 itérations du jeu d’origine… pouvaient pas en prendre un dans le tas, là ?), il est assez déplorable de voir rapidement que le bonhomme est en quête de sens, de rédemption et qu’il fait, forcément, passer sa femme et sa fille au-dessus de ses propres priorités.
C’est très sympathique. Mais naaaaaaze. Tellement vu et revu que je me demande encore pourquoi des scénaristes se lancent dans ce genre de débilité. Pourtant le film prend le parti de ne pas nous épargner la violence visuelle du jeu vidéo d’origine, enchaînant les fatalités sanglantes de bon cœur. Le fait d’avoir réalisé le tout sur un budget relativement faible aide également : 55 millions de dollars de production, ça permettait même aux producteurs de laisser tomber le côté bien-pensant et viser le NC-17 (ils ne sont pas passés loin, visiblement). Et malgré cela, ils nous tapent l’histoire d’un type/combattant lambda dont le passé et la vie ne nous intéresse pas, sans parler de l’enjeu émotionnel inexistant de sa quête personnelle. Je plains même le pauvre Lewis Tan qui, même s’il est sans doute plein de bonne volonté, n’a rien aucun dialogue intéressant et n’a que des combats finalement anecdotiques. [SPOILER alert!] C’est lui qui tue un Gôro assez moche dans un « stage » oubliable et peu spectaculaire… [/SPOILER]
Seul le personnage de Kane sauve le film d’un ennui intersidéral. Interprété par le cabotin Josh Lawson comme le comic-relief badass du film, il vole toutes les scènes dans lesquelles on lui donne quelques répliques à balancer. Et ce personnage-là marche à merveille : pas de sentiment, pas de « voyage émotionnel à la con« , il est juste là pour la baston (et le pognon, évidemment). L’ensemble des autres personnages sont plus ou moins oubliables, de Jax à Sonya Blade en passant par Raiden ou Kung Lao. Seul Liu Kang, joué par un Ludi Lin au physique très proche de Bruce Lee, sort son épingle du jeu, en grande partie en raison du traitement un peu différent de son personnage (il est plutôt illuminé comme moine Shaolin, cette fois-ci). Et ne pas l’avoir pris comme héro/personnage principal était ma fois osé, mais pouvait fonctionner s’il avait eu un peu plus de temps d’écran en préparation du véritable Mortal Kombat.
Car de tournoi il n’y en a pas dans ce long métrage. Contrairement à ses maladroits prédécesseurs, le film de Simon McQuoid (dont il s’agit ici de la première réalisation suite à une longue carrière dans la pub) n’entame jamais réellement le tournoi. Au contraire, Shang Tsung essaie ici d’éviter le tournoi en tuant les participants terriens avant le début d’icelui (alors même que son équipe a gagné les neuf dernières éditions… grande confiance dans le collectif, bravo !). Du coup, les combats, bien que chorégraphiés correctement, tombent un peu comme des cheveux dans la soupe et semblent parfois un peu poussifs. On rigolera aux nombreuses références directes aux premiers jeux (du « Come over here! » de Scorpion au « Flawless victory!« ), mais passé le fan service sympathique, le tout sonne un peu creux.
Pire, si les effets spéciaux sont dans l’ensemble correct, les lieux de tournages choisis sont vides et sans personnalité. Quitte à faire du fan-service, j’aurais préféré qu’ils copient davantage de stage des premiers opus du jeu. Ici, on a stage du pont et… c’est tout. Même le temple de Raiden semble tellement générique qu’on sent le carton-pâte à 14 kilomètres. Et je ne vous ai pas encore parlé de l’équipe des méchants. Shang Tsung, le sorcier maléfique, ressemble ici une version cheap de sorcière sortie d’un tokusatsu (je dis bien sorcière, ce n’est pas un typo : ses cheveux longs filasses et ses habits vaporeux et flottants font plus travello à la petite semaine que démon maléfique). Et ses sbires, Mileena, Nitara et Reiko (du lourd, quand on se rappelle les jeux) sont sous-exploités de manière totalement éhontée (bon, pour Reiko, vu qu’il est « joué » par Nathan Jones, ce n’est peut-être pas plus mal…) Côté méchant, donc, seul Kabal sort son épingle du jeu, en parfait miroir de Kano et leurs échanges et combats respectifs sont plus amusants que tous les autres à suivre.
Reste quelques jolis plans avec Sub-Zero, plutôt bien interprété par Joe Taslim, dont je n’ai pas encore parlé. Valeur sûre de la saga et de l’univers de Mortal Kombat et personnage préféré de nombre de joueur, il ne s’en sort pas trop mal et on ne peut que saluer l’idée du scénariste d’avoir inversé le trope habituel de Mortal Kombat en faisant de Scorpion le gentil et de Sub-Zero le méchant. Le film, eu égard à son petit budget, est une réussite au box-office et entraînera certainement une ou des suites dans les années qui viennent. Espérons qu’ils trouveront une équipe technique plus inspirée pour insuffler un peu de vie dans ce qui est, à ce stade, un film d’art martiaux lambda, interchangeable et vite oublié.

 De
De  De
De  De
De 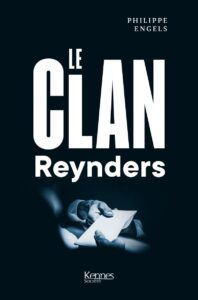 De
De