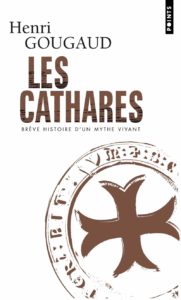 Sous-titré : Brève histoire d’un mythe vivant
Sous-titré : Brève histoire d’un mythe vivant
D’Henri Gougaud, 2008
Profitant d’une escapade en Aude et dans l’Hérault (avec le masque, zone verte, je vous rassure), soit en plein pays cathare, je me suis permis une petite incartade livresque sur le sujet, une parenthèse historique sur une page de l’histoire de France qui reste, finalement, assez obscur. J’avais lu il y a quelques années, à la suite d’un voyage précédent dans les mêmes terres, l’imposant Le bûcher de Montségur, de Zoé Oldenbourg. Le livre était passionnant, mais assez sec. Essai historique, il nous décrivait au jour le jour la fin de l’hérésie albigeoise sur la dernière citadelle du vertige qu’était Montségur. Ma frustration, relative, à la lecture de ce passionnant récit érudit et complet était qu’il présupposait que le lecteur était familier avec les cathares en général. Or, l’hérésie en question restait relativement embrumée dans les limbes du temps à mes yeux de pauvre amateur frivole.
Je cherchais donc, cette fois-ci, un ouvrage plus proche d’une introduction au catharisme. Le petit ouvrage d’Henri Gougaud me fit donc de l’œil, posé dans un rayonnage obscur d’une petite librairie perdue aux pieds des Pyrénées. Ne connaissant pas l’auteur, mais charmé par la quatrième de couverture, je me lançais. Et je ne fus pas déçu. Si le livre n’était pas exactement ce que je pensais, il n’en demeure pas moins une introduction érudite à ce qui est pratiquement devenu, au fil des siècles et des réécritures de l’histoire, un mythe.
Le premier point qui frappe est le style. Gougaud, qui a publié de nombreux ouvrages sur les contes en plus d’être un parolier entre autres pour Gréco et Ferrat, est ce que l’on pourrait appeler un troubadour moderne. Avec une gouaille aux accents locaux (l’homme est né à Carcassonne, on fait difficilement plus local !), un phrasé presque aussi rocailleux que la garrigue brûlante, Gougaud nous donne sa version de l’hérésie albigeoise (dont il a par ailleurs traduit en Français moderne la Chanson de gestion en 1989 aux Lettres Gothiques du Livre de poche). Il l’a connu toute sa vie, il l’a vécu, il l’a rêvé enfant, adolescent et adulte en s’asseyant sur les ruines de leur passé. Gougaud n’est pas un historien : il choisit donc de nous parler de sa propre expérience, de la manière dont ce fantôme du passé a touché et influencé sa vie d’homme du XXème siècle, d’occitan éclairé. Il nous parle donc de ceux qui, à partir des traces que l’archéologie et les historiens ont pu identifier, auraient pu être les cathares. Ou les albigeois, puisqu’il est fort probable que les cathares ne s’appelèrent jamais cathare, la dénomination n’étant réellement apparue qu’à la fin du XIXème, soit près de 900 ans après les évènements.
Et j’ai maintenant compris que le catharisme n’est en fait qu’une forme de protestantisme avant l’heure. Qu’un groupe d’hommes pieux se soit un jour insurgé contre ce que devait l’Église de Rome, s’attirant ainsi les foudres du Pape qui n’eut de cesse des éliminer jusqu’au dernier. Gougaud, lorsqu’il arrête de parler de lui à travers le récit de l’autre, résume également les principaux épisodes de l’épopée cathare, de son expansion aux croisades et à l’inquisition. Livre d’ambiance, avec quelques imprécisions historiques que j’ai moi-même repéré alors que je suis loin d’être un spécialiste (Gougaud glisse dans son récit la fable que Charlemagne fut stoppé devant les murailles de Carcassonne alors qu’il est établi qu’il n’a jamais fait le siège de la ville), il nous emmène avec lui dans un royaume de France moyenâgeux, beau, sec, dur et impitoyable. Plusieurs fois, j’eus l’impression de me retrouver dans Le Nom de la Rose tant le texte est fluide et romanesque. Et, au-delà du plaisir de lecture, j’ai pu mieux comprendre qui étaient les cathares, ce à quoi ils croyaient et pourquoi ils disparurent en raison des ambitions plus politiques que religieuses du Vatican et du Roi de France.
Le livre n’est en effet qu’une « brève histoire« , comme le précise le sous-titre de la réédition poche. Et les trous que la rigueur scientifique de l’historien universitaire laisseraient pudiquement vides sont ici remplis par ce conteur qu’est Gougaud, qui se plait à imaginer une vie potentiellement réaliste à tous ces protagonistes qui restent, effectivement méconnus (seuls quelques rites écrits par les cathares eux-mêmes furent retrouvés, le reste de leur histoire et de leur pratique nous étant connu uniquement à travers les récits des vainqueurs – et l’on peut douter de l’honnêteté de cette sympathique institution que fut la très Sainte Inquisition qui fut, je l’ignorais, créée spécialement pour l’occasion). Gougaud partage donc avec nous un livre agréable, particulièrement bien écrit et qui ouvre une fenêtre, certes parfois romanesque, sur un passé passionnant. Il se paie même le luxe, en guise de conclusion, de nous éclairer sur la manière dont l’histoire s’est emparée du mythe à travers les siècles pour défendre tout et son contraire, de l’irrédentisme occitan aux fumeuses théories liées au Saint-Graal qui furent reprises par nul autre que le IIIème Reich. Érudit et éclairant.

 De
De  De
De  De
De  Sous-titré Comsic fric-frac
Sous-titré Comsic fric-frac