 De Michael Dougherty, 2019.
De Michael Dougherty, 2019.
Troisième opus du MonsterVerse (après Godzilla en 2014 et Kong: Skull Island en 2017), cette nouvelle plongée US dans l’univers pourtant très japonais du kaiju eiga, le bien nommé Godzilla: King of the Monsters ne fait pas réellement dans la subtilité. On se retrouve quelques années après les évènements du Godzilla de 2014, dans le monde « d’après » la découverte des monstres géants. L’organisation Monarch, qui veille sur le gentil lézard, continue ses activités mystérieuses sous le regard assez suspicieux de divers gouvernements. Et on comprend que Godzilla n’est pas la seule grosse bêbête qu’ils surveillent. On se retrouve donc avec une gentille doctoresse (jouée par la toujours talentueuse Vera Farmiga) qui réveille la larve de Mothra avec une espèce de synthétiseur à émotions de monstres. Elle est accompagnée pour se faire par Eleven, heu… je veux dire par sa fille jouée par Millie Bobby Brown.
Malheureusement pour elles, quand elles arrivent à calmer une Mothra inquiète arrive tout d’un coup un groupe de paramilitaires/terroristes écologiques menés par Charles Dance. Ils embarquent tout ce petit monde (y compris le synthétiseur qui peut réveiller à distance tous les autres grands monstres qui vivent sous nos pieds à différents endroits du globe). Et à l’ex-mari, joué par le monolithique Kyle Chandler, d’endosser les vêtements du héros torturé en quête de rédemption qui retrouvera ses collègues de Monarch (y compris un Ken Watanabe que j’ai trouvé très fatigué) pour contrer les ambitions des Lannister… heu, de Charles Dance et sa bande de gais lurons. Car le brave homme a eu la mauvaise idée, dans son plan machiavélique, de commencer par réveiller King Ghidorah qui, comme chacun le sait, est l’ultime parangon de notre bienveillant lézard atomique.
Alors oui, le résumé est un tantinet moqueur. Mais il faut dire que le film ne brille pas par un scénario particulièrement brillant. Les scènes s’enchaînent de manière assez mécanique et convenue pour bien assoir le spectateur dans le rythme doux et ronronnant des blockbusters aseptisés qui ne prennent aucun risque. Les personnages sont tellement clichés qu’il est difficile de trouver quelque chose de réellement pertinent à dire sur eux. Les motivations du méchant passent du convenu au ridicule quand il se rend compte que son plan initial foire. Les rebondissements se voient venir à des kilomètres et certains personnages ne sont là que pour donner du temps d’écran au casting (Millie Bobby Brown, en particulier, que je trouve pourtant juste et parfois touchante dans Stranger Things, a le charisme d’un pot de fleur et l’utilité de radiateur en plein été dans le film).
Reste, bien sûr, les gros monstres. Et c’est ce qui rattrape au moins partiellement le film. Mon cœur de petit garçon ne peut s’empêcher de faire « ouaah » quand Godzilla se marave la gleu avec King Ghidorah sur grand écran. C’est spectaculaire, c’est efficace et c’est réellement la définition du plaisir coupable. Coupable car les scènes de baston, la clé du film, ne sont pourtant pas tellement centrales. Pas de chance pour nous, la pléiade de scénaristes et le réalisateur Michael Dougherty (surtout connu comme scénariste de superhéros) ont cru bon de s’attarder sur les humains. Grossière erreur. Du coup, Godzilla, qui est pourtant la star du film, passe finalement fort au second plan. Ses intervention (à l’exception sans doute de la bataille finale) sont parfois un peu poussives et n’ont pas le souffle épique que Gareth Edward, il faut bien l’admettre, avait réussi à insuffler dans le premier opus de 2014.
Bon, les effets spéciaux sont évidemment très corrects et la réalisation est professionnelle et léchée. La chorégraphie de certains combats est un peu brouillonne, mais dans l’ensemble, le côté visuel du film se tient. C’est d’autant plus dommage qu’ils n’ont pas pris un ou deux mois de plus pour une énième réécriture qui aurait donné un peu de personnalité à ce film. A titre de comparaison, Kong: Skull Island, avec son côté frondeur et irrespectueux de certaines conventions, était à mes yeux beaucoup plus réussi. Espérons du coup que ce Godzilla: King of the Monsters n’est qu’un faux pas dans une saga de série B friquée qui tenait plutôt la barre jusque-là. On verra bien dans le quatrième film, subtilement intitulé Kong VS Godzilla et qui devait sortir cette année (mais le Covid19 est passé par là), si la franchise repart d’un meilleur pied après un épisode très anecdotique.

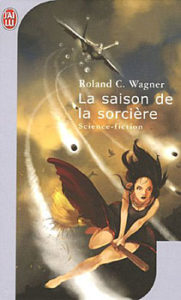 De
De  De
De  De Terry Pratchett, 1987.
De Terry Pratchett, 1987.