 De Jack Vance, 1946-1958.
De Jack Vance, 1946-1958.
Pour m’attaquer à Vance, légende de l’âge d’or de la Sci-Fi américaine, au même titre qu’Asimov, Heinlein, Bradbury et leurs collègues, je ne souhaitais pas me lancer dans l’une des sagas fleuves qui firent la renommée de l’auteur. Des Chroniques de Durdane, en passant par la Geste des Princes-démons, le Cycle de Tshaï ou encore Planète géante, Vance a marqué durablement les années 50 et 60 de la littérature de genre américaine. Comme ses collègues, cependant, il a bien sûr débuté par des nouvelles dans tout un tas de magazine pulp. Sjambak, recueil inédit publié en 2006 au Bélial’ en marge du projet VIE (Vance Integral Edition), regroupe quelques-unes des ces nouvelles précoces ainsi qu’une novella un peu plus longue, datée de 1958. Cela me semblait une bonne porte d’entrée à l’œuvre d’un auteur réputé être l’un des meilleurs conteurs de l’étrange du XXème siècle, spécialiste de l’exotique et du dépaysement.
On retrouve donc dans ce recueil une première nouvelle du nom de Les Maîtres de maison, publié en 1957 dans Saturn. Classique dans sa forme, elle voit une bande d’explorateurs humains débarquer sur une planète inconnue et rencontrer avec beaucoup de surprise des êtres humains qui leur parle en anglais et semble séparés en une caste de « maîtres de maison » et de « sauvage« . La nouvelle vaut surtout pour sa fin grand-guignolesque autant qu’elle est abrupte. Le second texte, La Planète de poussière, publié dans Starling stories en 1946, est la nouvelle la plus ancienne de l’anthologie. De fait, elle nous raconte la résistance d’un astronaute contre ses anciens compagnons de voyage qui ont décidé de l’abandonner dans l’espoir pour une sombre histoire d’arnaque à l’assurance. De l’aventure, des peuples extraterrestres et des explosions à gogo rythment ce texte très classique et très représentatif de la littérature pulp spectaculaire et divertissante.
Le troisième texte, qualifié de « roman » par l’éditeur, est plutôt une longue novella (200 pages à peu près), dénommé Parapsyché et publié dans l’Amazing Science Fiction Stories d’août 1958, ce qui en fait le texte le plus tardif de l’anthologie. On abandonne histoire les histoires d’exploration spatiale pour revenir sur le plancher des vaches terrestre. La novella, très didactique par moment, explore le domaine du surnaturel sous un angle alors sans doute assez osé : les protagonistes, ayant vu (ou cru voir ?) des fantômes dans leur jeunesse, n’ont de cesse d’explorer le domaine de la mort, du para-psychisme, de la télékinésie et des médiums. Le tout avec une démarche résolument scientifique et positive qu’ils opposent à l’obscurantisme prêché par l’antagoniste du récit, un pasteur illuminé qui prêche pour une Amérique propre, ordonnée et blanche. La charge virulente contre cette Église pentecôtiste, qualifiée ouvertement de fasciste par les héros de la nouvelle, me frappe réellement. Pour le reste, l’histoire tourne gentiment autours des expériences NDE (Near Death Experience) et me fait un peu penser à un épisode de X-Files où il n’y aurait eu que Dana Scully (la scientifique sceptique par excellence – au moins dans les premières saisons).
Sjambak, qui donne son titre au recueil, est la nouvelle suivante. Publiée en 1953 dans If, elle marque en effet le goût pour l’exotisme de Vance. Un reporter est largué bien malgré lui sur une planète perdue aux confins de l’univers connus où les colons, descendants croisés de cultures des îles du Sud-Est Asiatique et de la péninsule arabique, se livrent à des complots et autres djihads sous les apparats de cités états stables et pacifiques. C’est malin et plein de rebondissements, même si finalement assez anecdotique. Joe Trois-Pattes, le texte suivant, fut publié en 1953 dans Startling Stories. Conçu en quelque sorte comme un western de l’espace, où des prospecteurs de métaux ont maille à partir avec la faune locale d’un petit satellite tellurique. Amusant chassé-croisé où la tension monte pratiquement comme dans un huis-clos jusqu’à l’inévitable affrontement final.
Le Robot désinhibé, paru dans Thrilling Wonder Stories en 1951, est pour le coup un récit franchement malin qui oppose un employé un peu looser d’une société de transport interplanétaire avec une intelligence artificielle extra-terrestre qui déraille. Les passages de dialogue, à grand coup d’énigme mathématique (qui font sourire, quand on voit le temps que la brave machine met pour faire des opérations qu’un ordinateur digne de ce nom mettrait quelques millièmes de seconde à réaliser – mais bien sûr, nous sommes alors en 1951 et les ordinateurs fonctionnent avec des cartes perforées et font la taille d’un grand salon), sont particulièrement truculent. Je n’avais pas vu venir la fin, à nouveau plein de rebondissements et d’aventures en tout genre. Enfin, le recueil se termine par Le Diable sur la colline du Salut, publié en 1955 dans une anthologie éditée par son collègue Frederik Pohl. Cette dernière nouvelle est un peu plus hermétique et met à nouveau à mal l’ordre établi et la bonne foi chrétienne du missionnaire américain typique. Le texte est malin, même si cela se termine plutôt en queue de poisson.
Que penser de tout cela ? Et bien que c’est une entrée en mode mineure sur l’œuvre de Vance. Bien sûr, je vois dans ces textes pas mal de scories qui sont l’ADN des textes des magazines pulp des années 50. Ils sont relativement simples et mettent surtout en avant le côté extravaguant de l’exploration spatiale, le dépaysement des décors et des civilisations extraterrestres. On y trouve beaucoup d’action, d’explosions et de vengeance, mais également quelques sympathiques réflexions plutôt anarchiques que je ne soupçonnais pas à première vue. La novella Parapsyché en particulier semble être un texte plus personnel de l’auteur où il nous dit tout le mal qu’il pense d’une certaine frange catho intégriste américaine qu’il accuse à demi-mot d’être un frein à l’évolution, à la modernité et à la connaissance.
Ce n’est sans doute pas le meilleur recueil de nouvelle que j’ai lu ces dernières années, mais cela se lit vite et cela fait certainement voyager dans ces temps où les murs qui nous entourent pourraient vite se transformer en prison mentale (merci le confinement du au COVID-19…) Sjambak -le recueil dans son ensemble, pas la nouvelle éponyme- ne m’a cependant pas entraîné plus que ça dans l’univers de Vance, même si je lui reconnais volontiers une certaine faconde pour raconter des histoires captivantes. Il faudra que je retente l’expérience avec l’un ou l’autre de ses textes cette fois-ci considérés comme majeurs, textes qui hantent mon interminable PAL depuis de (trop) nombreuses années.

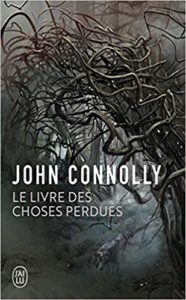 De
De 
 Sous-titré : ville, science-fiction et sciences sociales
Sous-titré : ville, science-fiction et sciences sociales De
De