 De Neil Gaiman, 2008.
De Neil Gaiman, 2008.
Je continue toujours à rattraper mon retard dans les Neil Gaiman, puisqu’il s’agit d’un auteur qu’en règle générale j’aime beaucoup (même si j’ai plus commenté des déceptions dans ces colonnes que de véritables coups de cœur). A l’instar du très moyen Entremonde, nous sommes ici dans le pan jeunesse de la production de Gaiman. The Graveyard Book, dans son appellation originale, a été inspiré à Gaiman par sa propre descendance. L’avoir comme père doit être une expérience intéressante pour un enfant féru d’histoire du soir. J’essaie moi-même de raconter des histoires chaque soir à mon fils, mais je suis prêt à parier que les miennes sont moins gothiques !
Fermons la parenthèse. Gaiman a donc l’idée un soir de raconter à sa fille (si mes souvenirs sont bons) l’histoire du fantôme d’une sorcière vivant dans une partie abandonnée d’un petit cimetière de quartier. Il tirera une nouvelle de cette idée. Et de cette nouvelle, en extrapolant un peu, il tirera donc L’étrange vie de Nobody Owens. L’histoire débute sur la fugue d’un bébé de 18 mois, qui s’enfuit par la fenêtre de sa chambre alors qu’un assassin répondant au nom de Le Jack décime sa famille au grand complet. Il s’enfuit et parvient à trouver refuge dans le cimetière en haut de la rue. Là, les habitants locaux, revenants, vampires et autres esprits frappeurs tiennent une courte réunion : ils ne peuvent décemment pas laisser le pauvre enfant tomber aux mains du bourreau de sa famille, qui franchi alors les portes du cimetière.
Leur décision est prise : ils chassent l’intrus grâce aux pouvoirs que certains d’entre eux ont développé et ils adoptent le nourrisson comme l’un des leurs. Ils le baptisent alors du nom de Nobody. Nobody Owens, du nom de ses nouveaux parents adoptifs, de braves citoyen morts quelques siècles plus tôt. Il deviendra donc un habitant du cimetière, vivant la nuit, se déplaçant sans bruit, pénétrant dans les tombes et subsistant grâce aux bons soins de Silas, un autre habitant du cimetière, ni vivant, ni mort.
Chaque chapitre du livre détaillera alors les aventures successives de Nobody, d’une amitié avec une petite fille du voisinage à son escapade dans le monde des goules (chaque cimetière a une porte vers ce monde onirique et dangereux, vous la reconnaitrez par son aspect négligé et les fissures de sa pierre tombale…). Nobody apprendra aussi des leçons de vie auprès des multiples revenants que son pré-carré héberge. Nobody passera donc de la petite enfance à l’adolescence sous l’aile protectrice des macchabées qui forment sa nouvelle famille. Jusqu’au jour où les murs du cimetière lui semblent trop étroits. Sortir de limites fixées par le domaine des morts est cependant dangereux : il risque de retomber sous le regard du Jack qui, après toutes ces années, n’a pas perdu l’espoir de finir son sombre travail…
La plume de Gaiman se prête bien sûr à merveille à cette fresque enfantine, ce coming-of-age story gothique et sombre. Bien que destiné à la jeunesse, il peut parfaitement se lire par un adulte sans tomber dans l’ennui, la caricature ou la sur-simplification (preuve en est : il a gagné le Locus jeunesse et le Hugo catégorie générale !). Au contraire, Gaiman use de son talent de conteur pour nous dresser une série d’historiettes qui peuvent sembler simples et décousues au début du livre (lorsque le protagoniste principal est encore un jeune enfant) et complexifie l’ensemble dès la moitié du livre. Les liens commencent à se former, les non-dits prennent leur sens. Gaiman n’a rien laissé au hasard : chaque piste ouverte dans les premiers chapitre apportent leur pierre à l’édifice et participent à la conclusion du bouquin.
Par ailleurs, Gaiman connait ses classiques : il sait qu’un conte doit être effrayant ou dérangeant pour marquer. Les aventures de Nobody ne sont donc jamais innocentes ou sans péril. Le danger est bien présent derrière la tombe la plus anodine. Et tout l’enjeu du livre est de démontrer qu’on grandit davantage en affrontant le danger, en affrontant ses peurs, en affrontant son destin qu’en le fuyant. Nobody est un personnage étrange, un héros malgré lui. Un enfant déconnecté du monde qui doit pourtant le rejoindre à un moment car il n’est, contrairement à sa famille adoptive, pas mort. Les morts qui semblent sympathiques et accueillant dans les premiers chapitres montrent d’ailleurs leurs failles et leurs faiblesses au fil du récit. S’ils ont de la compassion pour le petit Nobody, ils n’en demeurent pas moi, également, des âmes tourmentées.
L’étrange vie de Nobody Owens est donc un récit à plusieurs niveaux de lecture. Un récit de passage à l’âge adulte brillamment écrit où la morale, bien présente, n’est pas assénée à grands coups de sermons bienpensants. Aucun enfant ne voudra ressembler à Nobody. Pourtant tous voudraient le connaître. L’édition poche chez J’ai Lu, brillamment illustrée par Dave McKean, est un véritable cadeau à faire à vos enfants, qu’ils soient petits (bon, pas avant 7-8 ans quand même, hein !) ou grands. Tout comme Coraline quelques années plus tôt, un véritable classique en devenir.

 De
De 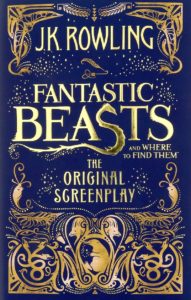 De
De 
