 De Raphaël Eymery, 2017.
De Raphaël Eymery, 2017.
Premier roman remarqué du jeune Raphaël Eymery (tous les auteurs qui sont nés après moi sont forcément jeunes !), Pornarina a été édité en poche il y a quelques mois dans la toujours excellente collection Folio SF de Gallimard. Lauréat du prix Sade du premier roman l’année de sa parution, en 2017, Pornarina est un texte difficile à décrire. De son propre aveu, Eymery y a mis ses obsessions et ses passions littéraires. Et, autant le dire tout de suite, le garçon a des obsessions et des passions bizarres. S’il fallait trouver un pitch en une ligne, je dirais que Pornarina, c’est Le Silence des Agneaux chez les freaks.
Résumons de manière un peu plus complète : Pornarina est un mythe, un croque-mitaine que seuls quelques esthètes pourchassent à travers l’Europe. Pornarina est « la prostituée à la tête de cheval« , une tueuse en série qui se débarrasse de ses proies en les émasculant. Et qui se nourrit d’un régime constitué uniquement de services trois pièces (pour ne pas tomber dans la vulgarité et alléger la critique, versons dans l’imagerie facile). Personne ne l’a jamais vu, simplement parce que personne n’a survécu à son éventuelle rencontre. Mais une confrérie de vieux bonhommes bizarres la traque, chaque membre espérant l’accrocher à son tableau de chasse pour une raison qui lui est propre.
L’un d’entre eux, le Dr. Blažek, est octogénaire reclus vivant dans son château gothique en France. Fils de sœurs siamoises ayant connu leur ère de gloire dans une Foire aux monstres du début du siècle, il est, avec les années, devenu collectionneur de toutes les bizarreries humaines. Son château renferme un véritable musée des instruments de torture, mais également des humains plastinés et toute une collection de cadavres de freaks divers et variés. Mais le joyau de sa collection n’est autre que Antonie, une acrobate qu’il a recueilli enfant car elle avait la faculté naturelle de se démantibuler toutes les articulations. Il l’a entraîné au fil des années pour en faire une véritable tueuse. Et le moment est venu pour le Dr. Blažek de la lancer aux trousses du Pornarina et ainsi accomplir par procuration son grand œuvre, apporter la dernière et ultime touche à sa collection.
Et je m’arrête là dans le résumé pour éviter de vous dévoiler davantage l’intrigue. Vous aurez cependant compris qu’on ne rigole pas des masses. De fait, si la quatrième de couverture parle d’une « famille Addams » européenne, je cherche encore la moindre trace de sourire dans ce thriller glauque. La question se pose d’ailleurs s’il n’aurait pas davantage sa place dans une collection thriller que dans une collection SF. L’élément fantastique, mis à part le côté très roman gothique de la plupart des personnages, se résume à la figure tutélaire de Pornarina que l’on évoque sans jamais la voir. Elle d’ailleurs au centre d’un conflit entre les « anciens » chasseurs, qui y voient une incarnation du mal, un véritable monstre qui court les villes européennes pour tuer les hommes, et les « jeunes » chasseurs, qui ne voient en elle qu’un ou plusieurs tueurs en série classiques avec, il est vrai, un mode opératoire assez sanglant.
Eymery mène son histoire tambour battant sans laisser au lecteur de moments de respiration entre ses chapitres. Il réussit même le difficile pari de rendre Antonie sympathique alors même qu’elle est, elle aussi, un psychopathe totalement inadapté à la société. Antonie est cependant la seule à avoir un système de valeurs assez classique (comprenez : humain) et en fait donc, par défaut, la figure d’identification du lecteur. [SPOILER ALERT] Quelle ne fut pas ma surprise, donc, quand l’auteur abandonne cette piste pour le dernier tiers du roman où Antonie devient Antonia, tueuse en série à son tour et où elle devient donc la figure noire, absente de la trame pour n’apparaitre qu’en meurtrière aussi efficace que froide. [/SPOILER ALERT]
Âmes sensibles, s’abstenir. Pornarina doit en effet beaucoup à Thomas Harris. Si l’ambiance générale du roman, dans les deux premiers tiers, ressemble fort à un hommage au roman gothique du XIXème siècle, le cœur du roman fait réellement penser à l’auteur de Dragon Rouge, d’Hannibal et du Silence des Agneaux. Eymery arrive donc à marier avec bonheur une ambiance sombre à la Bradbury de L’Arbre d’Halloween avec du thriller sanglant et explicite. Le dernier tiers m’a un peu désappointé, cependant, puisqu’il verse là davantage dans du Maxime Chattam ou à du Jean-Christophe Grangé. Il ne faut pas rougir de ces influences plus commerciales, car elles sont très efficaces en soit pour conclure un thriller. Mais elles laissent bien sûr un léger goût d’inachevé en bouche, car elles versent automatiquement dans un développement plus classique que ne le laissait croire l’ambiance du début. Un très bon premier roman cependant, sombre, glauque et sans espoir.
PS : si j’en crois le blog de l’auteur, il était toujours récemment occupé à écrire son deuxième roman. Et il nous met en garde qu’il espère trouver des lecteurs car ce deuxième livre sera « beaucoup plus sombre » que le premier. Ça promet !

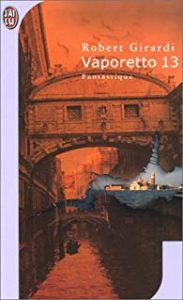 De
De 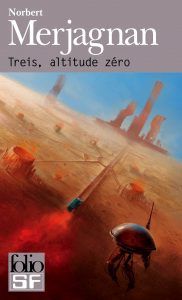 De Norbert Merjagnan, 2011.
De Norbert Merjagnan, 2011.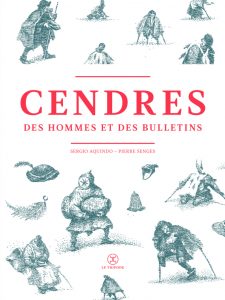 De
De 
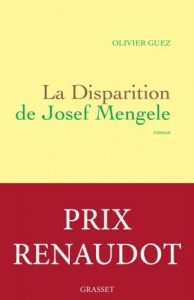 D’
D’