 Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.
Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.
Quelques jours après le premier volet de cette anthologie consacrée au « dangerous women« , je reprends donc mon clavier pour vous livrer mes impressions sur ce deuxième tome, consacré exclusivement aux auteurs féminins. J’en profite déjà pour corriger un oubli que j’ai honteusement commis lors de la rédaction de l’article consacré au premier tome : j’ai passé sous silence la magnifique couverture de Simon Goinard. Le tome 2 profite aussi des talents de l’artiste français. Il est sans doute bon de rappeler qu’il n’y a pas qu’Aurélien Police qui sait dessiner de ce côté-ci de l’Atlantique !
Passé cette digression, parlons du bouquin. Plus épais que la partie 1, j’avoue d’emblée être nettement moins familier avec les noms des auteures retenues par Martin et Dozois. Je n’en connaissais même que trois, pour être honnête : Lindholm (évidemment), Kress (bien sûr) et Gabaldon (ma femme a un trouble obsessionnel compulsif avec Outlander…). Les autres m’étaient inconnues. Et, probablement, pour la majorité d’entre elles, je ne vais malheureusement pas retenir leur nom. Car, de fait, cette deuxième partie m’a nettement moins marqué que la première. J’irai même jusqu’à dire que la proportion des textes marquants et anecdotiques s’est carrément inversée. Passons-les en revue un à un.
La première nouvelle, Soit mon cœur est gelé, est signé de la plume de Megan Abbott. Spécialiste du roman noir (dont je ne suis pas particulièrement friand, ce qui explique sans doute que je ne la connaissais pas alors qu’elle semble abondamment traduite en français), elle livre ici une très froide et inquiétante nouvelle en attaque de volume. Un couple est confronté à la disparition de leur fille unique et est l’objet de l’opprobre populaire quand la mère commence à avoir un comportement de plus en plus étrange et irresponsable. Racontée du point de vue du père, cette nouvelle a une conclusion qui fait froid dans le dos et qui m’a rappelé l’excellent Gone Girl, sorti il y a quelques années. Bien que ce ne soit pas mon genre de prédilection, cette première nouvelle était plutôt très bonne et augurait le meilleur pour le volume dans son ensemble.
Mais dès le deuxième texte, le soufflé retombe légèrement. Cecelia Holland (pas traduite dans nos contrées) signe avec La chanson de Nora une nouvelle historique sur les enfants d’Aliénor d’Aquitaine. La nouvelle suit en particulier Nora, l’une des filles de la fameuse reine. Si le texte est sympathique, il est également rapidement oublié. L’écriture est bonne et le timing soutenu, mais l’histoire est, en définitive, assez fade et laisse un goût d’inabouti en bouche. Mélinda Snodgrass, également peu traduite et auteur de scénario pour Profiler ou Star Trek, nous emmène enfin dans la SF avec Les mains qui n’y sont pas. La nouvelle, ayant pour thème l’usurpation d’identité, est amusante bien qu’assez classique. Cependant, elle souffre de deux gros défauts à mes yeux : elle met longtemps à débuter en nous présentant en premier lieu une situation qui n’est pas celle au cœur de l’histoire (et des protagonistes inutiles, donc) et… elle laisse au rôle féminin un rôle très accessoire. Du coup, je vois mal l’intérêt de l’intégrer dans l’anthologie (bon, elle a également travaillé sur Wild Cards et est donc une proche de Martin, ceci expliquant sans doute cela).
La nouvelle suivante, Raisa Stepanova, de Carrie Vaughn, nous emmène sur le front russe de la seconde guerre mondiale. On y suit les péripéties d’une femme pilote de chasse qui rêve de devenir un as du manche à balais et de descendre un max de Boches. Jusque-là, pas de problème. Mais… non, en fait, c’est tout : je ne sais pas quoi ajouter. Sympathique, mais assez vite oublié. On arrive enfin à un gros morceau : Les voisines, signé Megan Lindholm (qui est le vrai nom de l’archi-connue Robin Hobb) est une nouvelle d’un autre calibre. On y suit la vie de Sarah Wilkins, une vieille femme qui s’obstine à vivre seule dans sa grande maison, contre l’avis de ses enfants qui aimerait la placer en maison de retraite. Alors qu’elle a l’impression de perdre petit à petit pied, elle assiste à l’avènement d’un monde parallèle autour de sa maison aux petites heures du matin, monde étrange de brumes et de ruines, si proche d’elle… Sans vouloir spoiler, c’est certainement l’un des textes les plus forts du volume. Du très bon.
Shanon Kay Penman nous livre ensuite un second récit « historique » avec Une reine en exil qui nous conte les mésaventures de la reine Constance (du Saint-Empire germanique, vers la fin du XIIème siècle). C’est fort bien documenté, mais je n’ai pas vraiment accroché. L’auteure, inédite sous nos latitudes, a voulu développer une saga historique portant sur plusieurs dizaines d’années en une courte nouvelle. Du coup, l’histoire souffre de quelques raccourcis frustrants. Dommage, car nous avions effectivement là une forte femme qui luttait avec toutes les armes dont elle disposait pour être maitresse de sa vie.
Suite la deuxième nouvelle importante dans le tome à mes yeux : Deuxième arabesque, très lentement, est une très belle fable post-apocalyptique sur la place de la beauté dans un monde dénué de sens et de but. Signée par l’excellente Nancy Kress, la nouvelle est menée tambour battant et nous arrache certainement une larme dans sa conclusion. Pur récit de SF, il faut un certain brio pour marier du survival avec la pureté d’un ballet. Diana Rowland, elle aussi plus habituée au roman noir qu’à la SF ou à la fantasy, nous livre ensuite un texte très froid avec La ville Lazare. Un flic ripoux tombe sous les charmes d’une prostituée dans une Nouvel-Orléans moite et glauque. C’est sombre, c’est bien amené, c’est du bon polar. La chute se devine un poil trop vite, mais sinon c’est certainement une bonne surprise.
On enchaîne ensuite avec la superstar Diana Gabaldon qui nous livre ici une nouvelle assez longue (la plus longue du recueil) intitulée Novices. Centrée sur la jeunesse de Jamie Fraser (le bellâtre en kilt d’Outlander), ici accompagné par son (futur) beau-frère Ian Murray, on assiste aux tendres années des deux compères lorsqu’ils étaient mercenaires sur le continent. Bien que la nouvelle se laisse lire, je suis étonné que Gabaldon (elle aussi, grande amie de Martin) ai choisi de livrer une nouvelle centrée sur Jamie et non sur Claire (l’héroïne d’Outlander, pour les inattentifs, au fond à gauche). Et je confirme également qu’elle a un méchant réflexe à toujours parler cul quand elle ne sait pas comment faire avancer son histoire (Harlequin tendance SAS…). Si l’histoire est bien menée, le récit est finalement assez anecdotique pour celles et ceux qui ne suivraient pas son œuvre phare…
L’enfer n’a pas pire furie, de Sherrilyn Kenyon, dont j’ignorais jusqu’alors l’existence, me confirme une et une seule chose : je ne suis vraiment pas fait pour la bit-lit. Cette historiette d’une bande de jeunes qui cherche un trésor dans un cimetière indien (oui, vraiment) m’a fait penser aux mauvais slashers des années 90. Vous savez, ceux qui ont pris Scream au sérieux ? La présentation de l’auteure nous dit qu’elle est une superstar de la romance paranormale. Sans doute oui. Et ça confirme que ce n’est pas fait pour moi : c’est mal écrit, c’est mou, c’est super-cliché. Non, merci.
L’avant-dernière nouvelle, Les aides-soignantes, de Pat Cadigan (que je ne connaissais pas, mais qui a gagné une ribambelle de prix de SF) est assez surprenante. On y découvre la vie de deux sœurs : une expert-comptable qui voit avec moults soupirs arriver chez elle sa petit sœur, éternelle chômeuse, alors que leur mère commence à perdre la tête à cause d’Alzheimer dans une maison de repos toute proche. Le texte est prenant mais j’avoue que la conclusion en demi-teinte m’a laissé un sentiment de « tout ça pour ça ?« . Une curiosité, donc.
Le dernier texte, Les mensonges que me racontaient ma mère, est plus dans mes cordes. L’auteure, Caroline Spector, la femme de Warren Spector (vous savez, le créateur de… Wing Commander et d’Ultima 7, entre autres ?), est peu prolixe. Elle a travaillé un peu avec TSR et un peu avec Martin sur sa saga d’anti-super héros Wild Cards (l’autre grand œuvre de Martin, à côté du Trône de Fer). Et c’est plus ma came : deux Wild Cards, une femme qui projette des boules de graisse explosives et une femme qui créée et contrôle des zombies, se retrouvent l’objet d’une machination qui cherche à la décrédibilisé dans les yeux du grand public. On ajoute à ça une société secrète, d’autres détenteurs de pouvoir amusants et une origin story pas super-drôle mais très efficace et on a un texte court, nerveux et jouissif. C’est une belle surprise pour moi et une belle porte d’entrée pour moi dans le monde de Wild Cards, dont les premiers volumes de la très longue intégrale attendent depuis plusieurs mois dans ma PAL. Ils remontent un peu, du coup ! 🙂
Pour finir, que pensez donc de ce deuxième tome et cette anthologie globalement ? Et bien, au risque de me répéter, il y a, comme dans toutes anthologie de nouvelle, du bon et du moins bon. Si les textes marquants sont plus rares dans cette deuxième partie, la lecture combinée des deux tomes (+ de 1000 pages en poche, quand on prend les deux, quand même) reste agréable. Quelques très bons textes valent la peine d’être lu indépendamment quoi qu’il advienne. Cependant, il faut bien se l’avouer, l’anthologie passe un peu à côté de son sujet. S’il y a bien une moitié de textes qui nous présentent en effet des femmes fortes, l’autre n’y accorde pas réellement une importance primordiale et, ce, que les auteurs soient masculins ou féminins. Autre bémol : vendu dans la collection SF de J’ai Lu, il faut quand même préciser que nombre de textes n’appartiennent ni à la SF ni à la Fantasy, mais sont du domaine du polar ou du roman historique. Ce n’est pas en soit rédhibitoire, mais c’est assez étrange, comme choix éditorial. Bonne lecture à vous malgré tout si je suis parvenu à titiller votre curiosité sur l’un ou l’autre texte de ce bon gros pavé (divisé en deux dans sa version poche FR).
[Vers la partie 1]
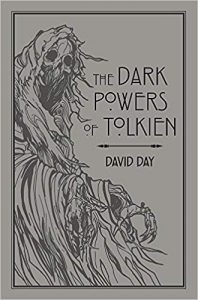 De David Day, 2018.
De David Day, 2018.
 De
De 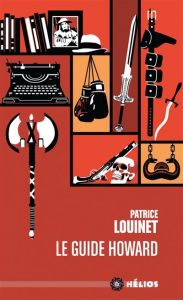 De Patrice Louinet, 2015.
De Patrice Louinet, 2015. Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.
Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.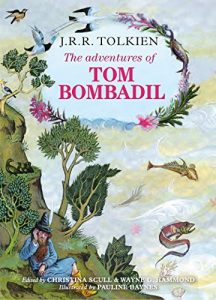 De J.R.R. Tolkien, 1962
De J.R.R. Tolkien, 1962