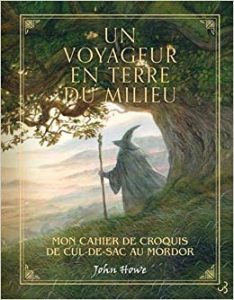 Sous-titré : Mon carnet de croquis de Cul-de-sac au Mordor
Sous-titré : Mon carnet de croquis de Cul-de-sac au Mordor
De John Howe, 2018.
Peu d’artistes ont su imposer « leur » vision d’un monde imaginaire comme John Howe. Avant même les trilogies néo-zélandaises de Peter Jackson, John Howe était déjà l’illustrateur à peu près officiel des œuvres de Tolkien. Son collègue Alan Lee, l’autre peintre de la Terre du Milieu engagé par Jackson comme designer/concepteur graphique sur les adaptations cinématographiques, est probablement le seul qui s’en rapproche. Car qui connait Ted Nasmith (en dehors des geeks de Tolkien) ? Ou qui se rappelle de Pauline Baynes, l’illustratrice originale des quelques œuvres publiées du vivant de Tolkien ? Ou qui visualise les illustrations de Tolkien même lorsque l’on évoque ses œuvres (là, j’exagère sans doute : plusieurs générations de lecteurs ont forgé leur image des hobbits à partir des rares illustrations du maître lui-même) ?
Tout cela pour dire que, depuis des années, c’est surtout John Howe qui a « forgé » le visuel de la Terre du Milieu et, même, sans doute, de la fantasy en général. Ses peintures les plus célèbres sont les images rémanentes que tout amateur de Tolkien a dans son esprit lorsqu’on évoque l’un ou l’autre épisode de la Guerre de l’Anneau, du Hobbit, de la Chute de Gondolin ou encore de la saga des Enfants de Húrin (bien que les couvertures des deux derniers soient signées… Alan Lee !)
John Howe, grand échalas barbu d’un âge désormais respectable, que l’on imagine aisément aussi amusant qu’un ascète après 10 mois de jeune, vit depuis de nombreuses années en Suisse, parmi les plus belles montagnes du monde, dont certaines ont inspirés l’auteur anglais dans ses écrits. Grand amateur du moyen-âge, il est également forgeron et n’hésite pas à enfiler une armure de plates lors de reconstitutions dont il est (fut ?) friand.
Mais, au-delà de ses anecdotes, il est également un artiste doté d’un coup de crayon exceptionnel. Et c’est cela que l’on retrouve dans le très beau livre objet publié fin de l’année passée chez Christian Bourgeois, l’éditeur classique de Tolkien en français. Pourquoi en français, me direz-vous ? Et bien parce que le livre est un cadeau (et qu’il fut acheté lors d’une dédicace en Belgique où seul le livre français était dispo). Et que, étant très largement graphique, cela n’a finalement que peu d’importance. Alors, bien sûr, je fus un poil perturbé par les traductions de certains noms et endroits, mais on retrouve vite ses chats (de la Reine Berúthiel ? -seuls les fanatiques de Tolkien saisiront-).
Que dire ? Le livre est superbe, bien sûr. Ayant opté pour une grande majorité de croquis dessinés (un peu plus de 200 crayonnés pour une quarantaine d’illustrations couleurs plus classiques), le format réduit de la publication ne gêne pas. De fait, on a l’impression de tenir le carnet de croquis que John Howe trimballa à travers la Nouvelle-Zélande pendant quelques années (quelques mois pour Le Seigneur des Anneaux, deux ans pour la trilogie du Hobbit, étalés sur plus de dix ans). Et on y voyage, en effet, de Bag-Ends (désolé, c’est plus fort que moi : je dois utiliser les noms anglais !) au Mordor en passant par Rivendell et Myrkwood. Les dessins sont d’un réalisme et d’une poésie rare, comme toujours avec Howe.
Le format de ce blog se prête mal à une galerie de photos visant à illustrer mes propos (d’autant plus que ces images sont toutes protégées par des copyrights amplement mérités), mais je gage que vous saurez faire une petite recherche dans Google image si vous ne connaissez pas le travail de Howe. Et même si cela ne devait pas être le cas : croyez-moi sur parole, Un Voyageur en Terre du Milieu vaut son pesant de cacahouètes pour tout amateur de Tolkien ou de médiéval-fantastique en général.
Les textes, courts, commentent les dessins pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu les épisodes illustrés. Pour les rares dessins qui ne couvrent ni le SdA ni le Hobbit, les commentaires seront donc utiles pour les néophytes. Pour les autres, vous n’apprendrez sans doute pas grand-chose à leur lecture. Cependant, reconnaissons que Howe a une belle plume et maitrise amplement son sujet. Les textes sont donc très agréables à lire malgré tout, même si le véritable objet du livre est et reste son côté graphique.
Intelligemment construit par thématique, on parcourra les diverses régions de la Terre du Milieu et les cités des diverses civilisations qui la peuple (des hobbits aux nains en passant par les efles et les hommes, bien entendu, sans oublier les orcs et autres trolls). Les quelques pages consacrées aux dragons, araignées, nazgûls et balrogs sont bien sûr à couper le souffle. Seul regret, peut-être : dommage qu’il n’y ait pas davantage de portraits. Bien qu’il soit un maître incontesté du paysage « épique« , Howe est également un très bon portraitiste, comme en témoignent les quelques exemples qui émaillent cet excellent carnet de croquis (easter egg amusant : Tom Bombadil, le grand absent de l’adaptation ciné, y est représenté avec le visage de … Peter Jackson !).
Un livre d’art accessible, tant par son prix que par sa taille, qui se doit de figurer dans la bibliothèque de tout amateur de fantasy ou de Tolkien en particulier. Même s’il réserve une part assez large à la trilogie du Hobbit (assez logiquement, puisque Howe a plus travaillé sur celle-ci que sur la première), le livre et son auteur ont aussi l’intelligence de se distancer suffisamment des films pour faire la part belle à l’œuvre fondatrice, aux écrits de Tolkien eux-mêmes et non à leur(s) adaptation(s). On est triste, au final, que le voyage ne soit pas plus long.

 De
De 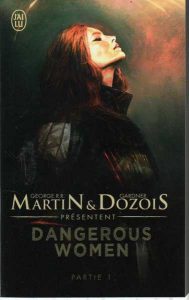 Édité par
Édité par 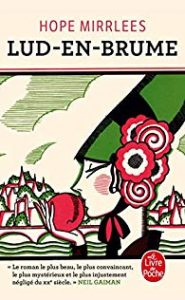 De
De 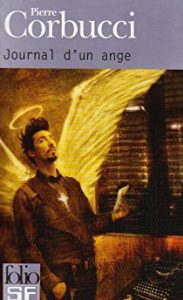 De Pierre Corbucci, 2004.
De Pierre Corbucci, 2004.