De Neil Gaiman, 2004.
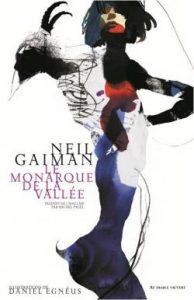
Quelques temps après les évènements relatés dans American Gods, le mutique Ombre a quitté les États-Unis et tente de se retrouver de l’autre côté des l’Atlantique. Un peu par hasard, il accepte un job de gardiennage pour une soirée VIP assez mystérieuse dans la campagne du nord de l’Écosse. Mais, pas de bol, la soirée dérape. Et il y est, bien sûr, question de Dieux oubliés qui se bastonnent, de personnages totalement excessifs et d’ambiance noires et gothiques.
Après plusieurs essais infructueux dans ces colonnes, voici donc un bon Gaiman a critiquer ! Au Diable Vauvert, éditeur historique de Gaiman en français, a eu la bonne idée de ressortir cette novella (ou nouvelle ? le texte est assez court) en 2017 dans une belle édition abondamment illustrée par Daniel Egnéus. La novella avait déjà été éditée précédemment dans le recueil Des Choses Fragiles, mais elle trouve ici un véritable écrin à sa hauteur dans cette superbe réédition qui fait suite à la republication d’American Gods illustré, lui-aussi, par Daniel Egnéus. Le monarque dans la vallée sera d’ailleurs suivi, quelques mois plus tard, par la publication du Dogue noir, la seconde novella de Gaiman mettant en scène Ombre comme personnage principal.
Que dire ? Pas grand chose si je ne veux pas vous dévoiler l’intrigue. La nouvella fait une petite centaine de page max (en fait, probablement une petite cinquantaine si on ne tient pas compte des illustrations) et il est difficile de développer davantage que dans le premier paragraphe ci-dessus. Ajoutons simplement que c’est du tout bon Gaiman : l’écriture est fluide, les personnages sont développés en quelques traits, l’histoire est haletante. Et, comme dans American Gods, on est emporté par l’incroyable flegmatisme d’Ombre qui subit le récit comme nous. La présence de Dieux/de légendes dans l’histoire offre en plus l’incroyable luxe de pouvoir utiliser des deus ex machina sans que cela ne semble être un artifice scénaristique éculé.
Le illustrations d’Egnéus, tout en clair-obscur, s’intègrent parfaitement dans le récit et servent le propos d’un bout à l’autre du livre. Par ses quelques coups de pinceaux, parfois à la limite de l’impressionnisme, Egnéus réussi à intégrer sa vision dans le texte comme un tout cohérent. A la différence du travail d’un John Howe sur les multiples textes de Tolkien qu’il a illustré, Egnéus ne livre pas des tableaux ajoutés en encart, mais bien des dessins qui se jouent de la pagination du bouquin. Je n’ai que rarement vu ça en dehors des histoires illustrés dans les livres pour enfants. D’une certaine manière, il adapte cette façon de faire (comme dans les récentes éditions illustrées des trois premiers Harry Potter) à de la littérature adulte, avec forcément un ton plus sombre et des illustrations parfois cauchemardesques.
C’est donc une très belle surprise que ce petit volume, dont le seul bémol est sans doute, justement, sa taille. Et, par conséquent, son prix. 22 euros pour une grosse heure de lecture, c’est évidemment pas donné. C’est un bel objet de collection à poser dans sa bibliothèque, mais Au Diable Vauvert aurait pu, il est vrai, joindre au Monarque dans la vallée la seconde novella, Le Dogue noir, plutôt que de privilégier une édition séparée. On leur pardonnera cette logique peut-être un peu trop visiblement mercantile (Gaiman est une valeur sûre) au regard de la qualité du travail d’édition, cependant. Du tout bon, qui m’a donné envie de relire American Gods ! (dont je n’ai toujours pas, honteusement, vu l’adaptation télé…)

 Édité par
Édité par  D’
D’
 De
De