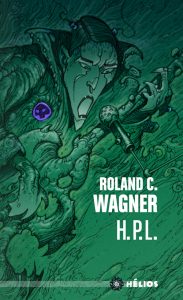 Suivi de Celui qui bave et qui glougloute
De Roland C. Wagner, 2006-2007.
Suivi de Celui qui bave et qui glougloute
De Roland C. Wagner, 2006-2007.
Réédité il y a quelques mois à l’occasion des 80 ans de la mort du reclus de Providence, ce court volume reprends deux nouvelles du regretté Roland C. Wagner, décédé malheureusement trop tôt voilà quelques années. Ce court volume (140 pages plus ou moins) renferme deux textes très différents l’un de l’autre. Le premier est une biographie fictive d’Howard Philip Lovecraft, si ce dernier n’était pas lui aussi mort jeune mais avait vécu jusqu’à ses 101 ans. Le second est une nouvelle plus classique, hommage là aussi aux monstres tentaculaires sortis des abysses insondables -et forcément indicibles- de l’imaginaire lovecraftien.
Dans le premier texte, H.P.L., Wagner se plaît à imaginer un Lovecraft qui réoriente sa production littéraire vers la S-F après la seconde guerre mondiale et qui prend progressivement le rôle d’un vieux sage de la littérature de genre (ce qu’il est, paradoxalement, effectivement devenu à titre posthume). Wagner en profite même pour corriger certains traits que les amateurs des œuvres lovecraftiennes sont toujours un peu gênés d’évoquer lorsqu’ils parlent de l’auteur : exit le racisme primaire dont il a pu faire preuve et sa sympathie étrange pour le régime nazi. Lovecraft, ici, se rend compte de son erreur et fini même par être inquiété par le maccarthysme dans les années 50/60 pour ses sympathie avec le socialisme.
Au-delà du côté amusant de l’exercice, il faut admettre que cette fausse bio est particulièrement bien pensée en ce qu’elle est crédible. Elle présente en effet une progression, tant littéraire que sociale, de la vie de Lovecraft et le tout tient très bien la route. Wagner démontre par ailleurs sa grande connaissance de l’œuvre du maître, mais aussi et surtout des aléas et travers de l’histoire éditoriale de son œuvre, dans leur version originale comme dans leur version française. Les notes en bas de page regorgent d’anecdotes vraies (ou presque vraies ?) sur l’édition des œuvres de Lovecraft en français, par exemple. Si Sadoul est cité à plusieurs reprises pour ses éditions de best-of des revues pulps (faudra un jour que j’en parle ici, d’ailleurs, étant grand amateur du genre), c’est surtout Bergier qui en prend pour son grade avec sa « lecture » totalement faussée de l’intention de Lovecraft et de ses textes…
Ce premier texte est suivi par une version anglaise du même texte. Il s’agit d’une adaptation plus que d’une simple traduction, puisque les nombreuses références au monde de l’édition francophone sont purement et simplement supprimées, lorsqu’elles ne sont pas remplacées par des références anglo-saxonnes (cependant moins nombreuses). L’effort est notable, mais je comprend mal l’intérêt de le publier dans ce court recueil ostensiblement destiné à un public francophone ? Soit, c’est un moindre mal.
Le troisième et dernier texte (après H.P.L et sa traduction anglaise) est donc Celui qui bave et qui glougloute. Vous imaginerez aisément qu’il s’agit d’un texte à vocation comique. Visiblement, symptomatique de la production de Roland C. Wagner (dont je lis ici la première œuvre, donc je sais difficilement juger par moi-même), il s’agit en effet d’une farce sur le fond qui développe cependant une véritable histoire avec un véritable enjeu dramatique. En deux mots, un groupe d’intellectuels américains, dans le but d’aider les indiens a résister à leur lente extermination par les conquérants de la Frontière, invoque malheureusement des créatures d’outre-espace qui n’ont pas pour ambition d’aider uniquement les indiens à mener un combat juste. Ils veulent aussi asservir l’humanité. Et la situation s’empire quand Washington reçoit à son tour l’aide d’autres créatures extra-terrestres qui, sous le couvert de vouloir équilibrer les chances, importe en fait un conflit millénaire sur Terre.
Et la solution s’impose : il faut invoquer un grand ancien qui va mettre tout le monde d’accord. Mais pas le plus malin ; celui qui bave et qui glougloute. Amusant à lire, la nouvelle invoque toutes les grandes figures que l’on associe volontiers au western : les Daltons, Camility Jane, Wyatt Earpt, etc., etc. Avec, au-dessus de tout cela, un couche de monstres chitineux et protoplasmiques. 🙂
Wagner a rédigé cette nouvelle à l’origine pour une recueil consacré au steampunk. Mais, comme on l’apprends dans la post-face du bouquin (composé d’interviews de l’auteur), Wagner n’est pas un fana de ce sous-genre, considérant qu’il n’apporte pas grand chose au fantastique dans son ensemble et qu’il a même plutôt pour effet de restreindre l’imagination des auteurs qui le pratique. Du coup, plutôt que de choisir bêtement un Londres (ou un Paris) brumeux au tournant du XIX siècle, comme dans 99% de la production steampunk, il a cadré son histoire aux États-Unis, sur la frontière de l’Ouest, la fameuse Frontière de la conquête de l’Ouest. Et il l’a mélangé à l’imaginaire de Lovecraft, pour notre plus grand plaisir de lecture. Mangez-en, les amis, c’est du bon.

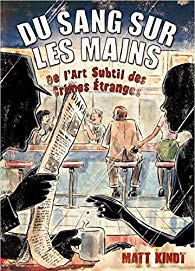 Sous-titré : De l’Art Subtil des Crimes Étranges
Sous-titré : De l’Art Subtil des Crimes Étranges De
De 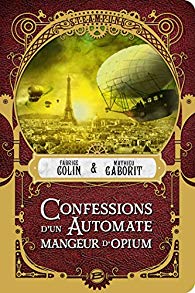 De
De  La trilogie cosmique, tome II
La trilogie cosmique, tome II