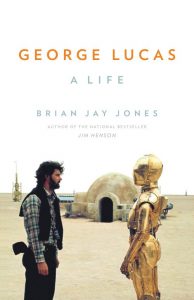 De Brian Jay Jones, 2016
De Brian Jay Jones, 2016
Je ne suis pas un grand lecteur de biographies, pour être honnête. Et encore moins de biographies de contemporains. Cependant, quand on vous offre un livre, il n’est que politesse d’au moins tenter de le lire. Et, quand le sujet touche de près ou de loin à Star Wars, cela ne peut que faire vibrer une corde sensible dans mon cœur de fanboy devant l’éternel. Dont acte. Près de 600 pages plus tard, l’heure du verdict tombe.
Puisque je sais ânonner à peu près la moitié des dialogues de la saga Star Wars de tête, j’ai par définition une relation relativement compliquée avec son père spirituel, l’iconoclaste George Lucas. Comme tous les fanatiques de l’univers, je le béni pour s’être battu et avoir réussi le coup de maître de l’épisode IV et je le maudis pour nous avoir imposé, entre autres, les midichloriens et Jar Jar Binks. C’est donc avec une curiosité mêlée d’appréhension que j’ai feuilleté les premières pages de la biographie « non-autorisée » signée par Brian Jay Jones, spécialiste de l’exercice ayant notamment signé une vie de Jim Henson et de Washington Irving. Non-autorisée, considérant que Lucas lui-même n’a pas réellement porté son aide à l’auteur.
C’est sans doute la première qualité de cette biographie, d’ailleurs. Elle n’est en rien hagiographique. S’il est évident que l’auteur est fasciné par le kid de Modesto qui a réussi à bâtir un empire médiatique tout puissant, il ne l’épargne pas moins quand il s’agit de décrire ses obsessions, ses erreurs et ses excès. L’autre force de cette biographie est George Lucas lui-même. Bien qu’il n’ait pas révolutionné la planète, qu’il n’ait sauvé personne à travers un engagement politique particulier, que ce ne soit certes pas un grand écrivain ou même un artiste remarquable, on ne peut qu’être impressionné par le parcours du bonhomme, qui doit sans doute autant à la chance qu’à un sens des affaires aiguisé.
Étudiant médiocre, fils d’une famille commerçante à succès de la petite ville de Modesto, Californie, rien ne prédestine le petit George a devenir un géant de l’industrie de l’entertainment de masse. Pourtant, à travers des choix plus ou moins contraints, il se retrouve assez vite à expérimenter du cinéma d’avant-garde. Cela donnera, par un coup de bol et l’aide de mentors successifs, dont l’inénarrable Francis Ford Coppola, THX 1138. Puis, sur un coup de bluff et pour prouver à sa femme qu’il savait aussi faire dans l’accessible, le facile, il signe malgré les embûches le grand succès populaire qu’allait devenir American Graffiti. Avant de s’atteler à un petit film de science-fiction réalisé en hommage à Flash Gordon et aux comics de sa jeunesse : la légende Star Wars est en marche. Bientôt suivie par la blague de potache qu’il signera avec son pote Steven Spielberg, le non moins fameux Indiana Jones.
Le bouquin de Brian Jay Jones se construit d’ailleurs sur cette temporalité. Une première partie, très factuelle, sur les années galères. Une seconde, incrédule, sur le lancement de la machine, et une dernière, plus courte et davantage orientée sur les regrets et les espoirs déçus de Lucas, sur sa fin de carrière, du status quo d’ILM à la vente de LucasFilm à Disney. Cette biographie se lit comme un roman. Bourré d’anecdotes qu’il me faudra remplacer de temps à autre pour faire le malin (Lucas a tourné plusieurs scènes de l’épisode III avec un teeshirt « Han shot first« !), on y suit la vie de Lucas comme ont suivrait la vie d’un héro de tragédie. De succès en doutes, en passant par ses prises de risque et sa vie sentimentale, tout est magnifiquement orchestré pour nous faire aimer ce vieux barbu à la voix haut perchée. Présenté comme un homme de contraires (passionné par la réalisation, mais n’ayant rien réalisé pendant 22 ans; excellent business man, mais pas intéressé par l’argent; doté d’une vision novatrice, mais incapable de la communiquer à cause de sa légendaire incapacité sociale, etc.), comme un véritable personnage de roman, je doute que George Lucas soit aussi complexe ou ambivalent que cette bio nous le laisse paraître.
Cependant, il faut bien l’avouer, George Lucas: A Life se lit vite, facilement et est, définitivement et certainement, amusant à lire. Que ce soit pour ouvrir de grands yeux quand Lucas décide de vendre Pixar « car il ne sait pas trop quoi en faire » pour une bouchée de pain à Steve Jobs, pour l’admirer quand il lutte de toutes ses forces contre le système des studios ou pour le détester quand il persiste et signe en expliquant que « oui, il a toujours été prévu que Greedo tire en premier« , on ne peut s’empêcher d’être fasciné par cette épopée moderne, à l’américaine, où David fini par être plus fort (et plus riche) que Goliath. Je remarque d’ailleurs que le bonhomme qui s’est battu toute sa vie contre la toute-puissance mercantile des grands studios américains, au nom de l’art, a fini par vendre ses bijoux les plus précieux à Mickey Mouse, alors que ce dernier produisait déjà l’univers Marvel, véritable vache-à-lait aseptisée et sans ambition qui abreuve le monde d’un message mainstream, incolore et inodore afin de faire le plus de profits possible. Comme, d’ailleurs, un certain George Lucas avec Star Wars et la machine du merchandising qu’il a en grande partie inventé, patenté et rentabilisé. La boucle est bouclée.
Reste à conclure sur le livre en tant que livre : érudit, documenté, se basant sur des interviews de proches comme sur l’abondante littérature produite préalablement, Brian Jay Jones est certainement un bon biographe. Il sait mettre en avant le mythe tout en le contrebalançant avec des faits et des interprétations davantage polémiques. Tout comme son objet d’étude, ici, il mixe bien le commercial et le réel. Le livre a même des chances de plaire à ceux qui s’intéressent tout simplement à l’histoire du cinéma et qui ne sont pas particulièrement fan de sabres laser ou de vieux barbus aux noms asiatiques. Bien que lu en VO, je signale que le pavé est également disponible chez Hachette en français sous le titre de George Lucas : Une vie (sans blague).

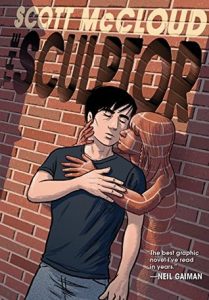 De
De  D’
D’ De Michael Dudok De Wit, 2016
De Michael Dudok De Wit, 2016 D’
D’