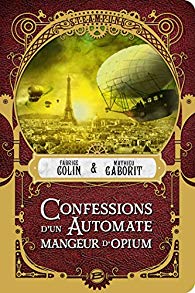 De Fabrice Colin et Mathieu Gaborit, 1999.
De Fabrice Colin et Mathieu Gaborit, 1999.
Deuxième titre du line-up de départ de la nouvelle collection poche « Steampunk » de Bragelonne, j’espérai que ce roman allait davantage me plaire que le très léger Club Vésuvius, dont il a déjà été question dans ces colonnes. Et la réponse est : oui et non. Écrire un roman à quatre mains est parfois un exercice ingrat. D’autant plus lorsque le choix est fait de développer deux personnages principaux, dont les histoires s’alternent de chapitre en chapitre. Car, dans ses conditions, il devient assez périlleux d’assurer une cohérence de style et de forme qui ne donne pas l’impression de lire deux livres à la fois.
Ici, Mathieu Gaborit (l’auteur des Chroniques de Crépusculaire) et Fabrice Colin (Winterheim) s’en sortent assez bien. Si l’un est plus sombre que l’autre (et je soupçonne fortement Colin de s’être chargé de la protagoniste féminine de l’histoire, dont le parcours est définitivement moins jojo), le cadre général est cohérent et on a effectivement un sentiment de progression de l’intrigue au fil des pages. Les Confessions d’un automate mangeur d’opium nous plonge donc dans un Paris fantasmé de la fin du XIXème, où la toute nouvelle Tour Eiffel partage le skyline parisien avec des engins volants marchant à l’éther, combustible ressemblant à une brume verte, dangereuse pour l’homme.
Dans ce cadre très steampunk (mérité cette fois-ci, contrairement au Club Vésuvius), une actrice de cabaret est confrontée à la mort d’une de ses amies, dont la chute d’un véhicule volant semble avoir été déguisé en suicide. Face à l’immobilisme de la police, elle décide d’enquêter elle-même sur ce qu’elle devine être un meurtre impliquant, peut-être, un automate pensant. Secondée par son frère, médecin à ses heures perdues, elle n’aura de cesse de débusquer les vrais coupables, au risque de sa propre vie et malgré des enjeux dont la complexité la dépasse. Les chapitres centrés sur Margaret, l’actrice, alterneront donc avec les chapitres centré sur Théo, le médecin, soit les aventures d’une Adèle Blanc Sec dévergondée à celles d’un dandy qui trouverait parfaitement sa place dans les romans de Pierre Pevel (cf. Le Paris des Merveilles).
Le tout s’enchaîne avec un brio certain, une écriture assez maîtrisée et des rebondissements allant crescendo. Mais dans ce cas, pourquoi ne suis-je qu’à moitié convaincu, allez-vous me dire ? Et bien peut-être la prétention du livre. Sorti pour la première fois en 1999, alors que la « mode » steampunk n’en était qu’à ses balbutiements de ce côté-ci de l’Atlantique, Confessions d’un automate mangeur d’opium sortait avec comme argument de vente d’être « le premier roman steampunk français« . Je ne sais s’il s’agit d’une volonté des auteurs ou d’un argument éditorial, mais il me semble que c’est mettre un peu vite de côté un certain Jules Verne, entre autres. Je sais bien qu’à l’époque de Verne le « steampunk » n’était pas du rétro-futurisme comme c’est le cas maintenant, mais simplement de la science-fiction, mais je trouve un peu malheureux de le passer sous silence, comme si Gaborit et Colin avaient inventé un genre.
Soit. Ceci ne serait qu’un point de détail si Confessions d’un automate mangeur d’opium avait été une œuvre phare, servant de modèle à un genre littéraire. Malheureusement, le bouquin ne fait que recycler les bonnes idées que des auteurs anglo-saxons avaient eu sur le sujet pendant les deux précédentes décennies, se contenant d’y ajouter une french touch un poil décadente. Je reproche donc au livre de ne pas prendre assez de risques. On y trouve de très bonnes idées (la partie où Margaret « habite » le corps de l’automate, par exemple, est très efficace par son côté oppressant et tragique) et d’intéressantes réflexions sur des questions d’actualité, comme les risques liés à l’intelligence artificielle. Mais, pour autant, le livre ne va pas jusqu’au bout de ces pistes et poursuit son petit bonhomme de chemin de manière relativement convenue. Je regrette, comme je l’ai fait il y a peu de temps avec Druide d’Olivier Peru, que certaines idées ne soient qu’esquissées pour finalement ne pas être exploitées dans la suite du récit. Le rôle du « créateur » de l’automate, démiurge complètement malade, a une fin tellement abrupte qu’elle est anti-climatique et un peu vaine dans la trame du récit, par exemple.
Mais bon, je pinaille. Le bouquin est agréable à lire et prenant malgré tout. Il ne marquera pas l’histoire de la littérature (même de genre), mais, pour finir, ceux qui le font réellement se comptent sur les doigts d’une main. Confessions d’un automate mangeur d’opium aura donc eu le mérite de me réconcilier avec la nouvelle collection poche de Bragelonne dont je testerai sans doute les prochains titres. En me laissant, malgré tout, un petit goût d’inachevé et de trop peu dans la bouche.
