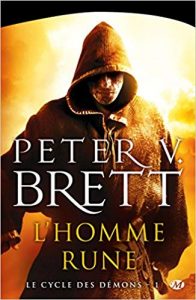 De Peter V. Brett, 2008.
De Peter V. Brett, 2008.
1er tome du Cycle des Démons.
Sous l’affreuse couverture de Milady (c’est souvent le cas avec eux, mais cela ne devrait que moins arriver à l’avenir, maintenant que Bragelonne publie sous son nom les poches de fantasy et de SF et laisse à Milady la bit-lit et autre littérature rose) se cache le parfait exemple de la big-selling-fantasy. J’ai déjà évoqué ci et là dans certaines de mes critiques sur ce blog ce concept très anglo-saxon. Mais qu’est-ce donc, me direz-vous ? La big-selling-fantasy est tout simplement une certaine forme de formatage commercial du récit de fantasy. Le principe est simple : vous prenez un jeune garçon, orphelin si possible, et vous lui faites traverser des épreuves successives de plus en plus dures (comprendre : des monstres de plus en plus badass) jusqu’à faire de lui l’élu d’une nation/d’un continent/d’une monde. Sans oublier de lui adjoindre des side-kicks qui viendront se greffer à sa suite par le grand pouvoir de l’amitié (ou de l’amour, c’est selon le sexe du side-kick) pour former une « seconde famille« .
Les esprits chafouins me rétorqueront qu’il ne s’agit pas là d’un trait propre à la fantasy, mais qu’on touche tout simplement aux fondamentaux du récit, tel qu’il existe depuis que l’homme est homme (et, accessoirement, depuis que le vieux de bande gagnait sa pitance du soir en racontant des histoires, puisqu’il n’était plus capable de bouger son cul pour attraper à bouffer). Et vous auriez raison. Cette trame ne diffère que peu du « coming-of-age » story qui regroupe 50% des récits humains, si l’on exclu l’auto-fiction propre au XXème siècle. En effet, l’archétype du récit que j’ai résumé en quelques mots ci-dessous s’applique aussi bien à Oliver Twist qu’à Harry Potter ou à Naruto (car, oui, la fantasy n’est pas bien loin des recettes ultra-codifées des shonens). Ou même dans la Bible, pour le même prix.
Mais donc, pourquoi mon obsession pour cette prévisibilité dans les romans de fantasy alors ? Parce que la corde est tellement usée que j’ai du mal à constater qu’on tire encore et toujours dessus. Alors, bien sûr, Brett n’est pas un manche. Son beau pavé de 650 pages, premier tome d’une pentalogie (rien de moins que cela), nous présente avec moult fracas les trois personnages principaux de sa future grande saga. Arleen, le semi-orphelin doué qui est amené à devenir le sauveur de la nation contre des ordres de démons. Leesha, la clerc de la bande, rejetée par une partie de son village mais avec un cœur gros comme ça dans la main. Et Rojer, le saltimbanque orphelin (car, oui, un seul ne suffit pas) qui trouvera son courage pour affronter ses démons tant intérieurs que réels. Ais-je réellement besoin d’en dire plus ? Oui, sans doute. Brett a au moins l’originalité de développé un adversaire original. Point de nécromant nordique (comme dans 50% des romans de fantasy) sans ses pages : à chaque crépuscule, des démons élémentaires sortent du sol et s’attaque aveuglément à tous ce qui bouge. Seule parade pour les gentils humains : peindre des runes magique au seuil de leur porte et autours de leur grange pour éviter l’annihilation.
Et c’est dans ce monde désespéré, engoncé dans une passivité protectrice et fatalisme général que nos trois protagonistes vont se lever et décider de changer la donne : la meilleure défense, c’est l’attaque, c’est bien connu. Ce premier tome ouvre également des portes sur des développements futurs, avec notamment quelques indices sur l’origine des démons (peut-être un nécromant… venu du Nord ?) et sur les conflits politiques entre les diverses cités-états qui ne manqueront pas d’éclater. Le court passage dans la cité arabisante du Sud désertique, avec ses propres légendes et ses propres codes de conduite, laisse présager un méchant « conflit culturel » dès le prochain tome, avec trahisons et bassesses à la clé.
Que dire d’autre ? Que je suis sans doute étonné que Brett parvient à nous tenir pendant 650 pages juste pour installer ses personnages. Sans que cela ne paraisse trop long ou trop haché (ce qui est toujours un risque, dans les sagas à protagonistes multiples). Du coup, ça assure question attachement aux personnages, même s’ils ne sont finalement pas originaux pour un sous. Je suis donc fasciné qu’après toutes ces années cela continue à fonctionner avec moi. Je faisais le parallèle avec le shônen en début de texte : bien que j’en ai lu des dizaines et que je vois les mécanismes transparaitre avant même d’appréhender le récit, je me fais quand même avoir quand je tombe sur un shônen de qualité (genre One Punch Man ou l’infatigable One Piece). Et cet Homme Rune est du même tonneau : c’est de la bonne.
Brett le dit d’ailleurs lui-même sur son site officiel : ses inspirations sont Tolkien (of course) et Terry Brooks (Shannara, vous savez, ce plagiat insipide du SDA ?). Et c’est exactement ce qu’on a avec l’Homme Rune, un savant mélange entre de la fantasy qui se veut épique et de la production à la chaîne sans saveur. Le mélange des deux donne cette grosse brique, parfaite lecture d’été, qui se lit très vite avec un sourire un peu benêt aux lèvres quand on tombe sur un rebondissement tellement éculé que même nous, pauvres amateurs, n’aurions osé l’utilisé. Brett, lui, le fait. Avec un certain brio. En très résumé : une lecture agréable, qui ne fait pas de mal à une mouche, mais qui use de mécaniques bien huilées pour amener son lecteur en terrains connus. Dommage qu’il n’ose pas « tenter » quelque chose, comme un Mark Lawrence ou un Joe Abercrombie. C’est probablement ça, le défaut de ce cycle des démons : il est trop sage. Rendez-vous au deuxième tome pour, sans doute, confirmer ces sentiments.
