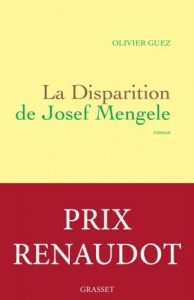 D’Olivier Guez, 2017.
D’Olivier Guez, 2017.
L’auteur, journaliste, a préféré utiliser la forme romanesque pour nous raconter les années d’exil de Josef Mengele en Amérique du Sud, de sa fuite aux lendemains de la seconde guerre mondiale jusqu’à son décès, bien des années plus tard, sur une plage brésilienne anonyme. Et il y a une raison à ce choix : Guez, déjà brillant essayiste avec L’impossible retour : une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945, a tenté de coller au plus près de la réalité factuelle dans ce court roman. Mais, même maintenant, des années après, la (sur-)vie de l’Ange de la Mort d’Auschwitz est encore marquée d’ellipses où seul le romancier peut combler autant que faire se peut les trous sans tomber dans le sensationnalisme.
Car La disparition de Josef Mengele est tout sauf un livre sensationnaliste. Que du contraire : le bouquin nous livre froidement l’errance du monstre nazi d’un pays d’Amérique du Sud à un autre. Un temps requinqué dans l’Argentine de Péron, véritable éden pour les ex-SS et autres nazillons en tous genres, Mengele poursuivra son errance au Paraguay et finira au Brésil, fuyant successivement ses poursuivants, qu’ils soient réels ou imaginaires. Le livre ressemble presque à un journal, décrivant par le menu la déchéance progressive de Mengele, perdant peu à peu pied avec le monde qui l’a engendré.
Ce portait factuel, qui éclaire d’un lumière bienvenue la sombre légende de l’Ange de la Mort, est aussi un livre dérangeant à bien des égards. De fait, Guez s’obstine, par sa position neutre dans la grande majorité du roman, à ne pas juger son objet. Ce n’est que bien tard, dans les derniers chapitres, que Mengele sera finalement confronté à un œil extérieur et questionné sur ses exactions, par nul autre que son propre fils. S’il est salutaire de retracer la vie ordinaire d’un boucher qui se cache, il est aussi finalement assez perturbant de ne pas être confronté (ou rarement) à la réalité des actes qui lui furent reprochés. Car Mengele fut un monstre extraordinaire (les témoignages sont nombreux et recoupés), mais ne fut également en définitive également qu’un « petit fonctionnaire du mal« . Souffrant d’un complexe d’infériorité par rapport aux nazis superstars de l’immédiate après-guerre, Mengele deviendra lui-même l’archétype du monstre inhumain, la définition même du criminel contre l’humanité, dès que ses agissements furent connus et diffusés. A tel point que, et le livre le souligne bien, les médias ont commenté sa traque pendant des années, lui prêtant les traits et les aptitudes d’un méchant à la James Bond par des épisodes aussi rocambolesques que faux.
La réalité était plus prosaïque : l’homme se terrait simplement et, petitement, vieillissait de planque en planque, abandonné progressivement par tous les nostalgiques du Troisième Reich à cause de son caractère irascible, de ses exigences outrancières et, plus prosaïquement, du simple temps qui passe. Et c’est là où le livre me dérange le plus, finalement. En le refermant, j’avais la même impression qu’après avoir visionné La Chute d’Oliver Hirschbiegel : à escamoter le crime et à décrire « objectivement » la vie des protagonistes, on en viendrait presque à excuser l’homme derrière le monstre.
Or rien n’est plus dangereux. Si Guez termine son roman par un rappel que le mal rôde toujours et que les conditions peuvent transformer n’importe quel homme en monstre, il me semble que ce constat est un peu court. Le contexte et les conditions font également naître les héros. La résistance. Le courage plutôt que la facilité. Si j’admets volontiers que Mengele était certainement un produit de son temps (ce qui est une explication et non une excuse), il devait avoir aussi certaines prédispositions pour faire ce qu’il a fait. Je ne parle évidemment pas d’eugénisme, ici, mais bien de choix personnels. On ne dédouanera jamais à mes yeux un homme qui a perdu à ce point ce qui fait justement de nous des humains. Mengele était un moins que rien. Un sadique, un fou, un monstre. Et il ne méritait pas la douce vie que l’Amérique du Sud a su lui offrir. Se plaindre, comme il le fit pendant les quarante dernières années de sa vie est juste une ignominie. Sa place était devant la justice, pour expéditive qu’elle fut face à l’inhumain.
Et, malheureusement, le livre d’Olivier Guez ne rends pas, à mes yeux, suffisamment justice à cette lecture des évènements. C’est en cela que le parallèle avec La Chute me frappe : ce sont deux œuvres importantes, intéressantes, qui offre un regard inédit et instructif sur des épisodes que le temps qui passe a tendance à rendre plus mythique qu’historique. Mais sans mise en garde particulière, sans contextualisation et rappel d’autres faits objectifs (les morts, les tortures, l’inhumanité devenue ordinaire), il peut manquer des clés de lecture essentielles aux lecteurs occasionnels. Nul doute que le jury du Renaudot de 2017 était familier avec la Shoah et ses protagonistes. Mais dans dix ans, dans vingt ans, le lecteur d’alors sera-t-il capable de faire la part entre l’histoire et le mythe ? N’y verra-t-il pas, comme Mengele n’arrête pas de l’exprimer dans ce livre, un acharnement excessif contre « un exécutant » ? Bien que ses crimes les plus odieux sont finalement cités dans le livre (plutôt vers la fin), il me semble qu’un intro de deux trois pages qui « chiffre » froidement, là aussi, l’ampleur de la folie et de la monstruosité du protagoniste principal du livre aidera à mettre en garde le lecteur : oui, Mengele était un homme. Non, il n’était plus tout à fait humain.
Et si vous pensez que je prends trop de précautions et que je vois un problème qui n’existe pas, que je suis finalement parano ou peu confiant dans l’intelligence du lecteur, je ne peux que vous répondre une chose : la bête rôde toujours. Et elle semble reprendre des couleurs, quand on voit le triste état de la démocratie en Europe et le repli que cela provoque sur le pouvoir électoral des puants d’extrême droite en tout genre. L’histoire se répète et la mémoire est courte. En résumé : un livre polémique, intéressant, souvent très bien écrit, qui « normalise » un psychopathe que l’on a bien voulu faire passer pour un « super-méchant« . Mais aussi un livre à expliquer et à cadrer, si l’on veut éviter l’effet inverse que celui du propos de son auteur.
